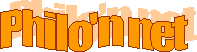 AUTRUI
AUTRUI
La conscience morale
Le pouvoir
Introduction
La conscience morale suppose un monde peuplé par d’autres hommes. La morale n’a pas de sens dans la nature : seuls des hommes peuvent donner collectivement du sens et de la valeur à des objets biologiquement sans utilité. C’est en dépassant ce niveau de la nécessité que les hommes accèdent à l’humanité.
Un tel postulat initial demande une explication. La présence d’autrui à mes côtés, les échanges que nous établissons relèvent-ils d’une nécessité ? Ou bien encore, l’amour ou la haine que nous nous portons sont-ils de l’ordre du choix ? Dans le premier cas, si nous ne pouvons être sans autrui, si nous n’avons pas le choix de vivre sans lui, il ne relèverait pas d’un questionnement moral : il serait, et je serais pour lui une dimension incontournable de ma condition, au même titre qu’on dit de l’homme qu’il est mortel par exemple. Dans le second cas, dans la mesure où j’ai le choix d’aimer mon prochain comme moi-même ou de me servir de lui pour satisfaire mon intérêt, la relation à l’autre relève d’une interrogation éthique.
La problématique du pouvoir permet de lever le doute : autrui qui est originellement une nécessité pour moi est bien une question éthique. En effet, si l’on admet selon M. Foucault « que le pouvoir est partout » cela veut dire que nous sommes les uns par rapport aux autres dans des relations où se joue toujours l’enjeu d’un pouvoir. Car si autrui me fait découvrir ma propre conscience, mon autonomie de pensée, il me fait découvrir du même coup que j’ai un intérêt propre à satisfaire, éventuellement à ses dépens. Comment la relation à l’autre peut-être dans ces conditions vertueuse ? Comment passer du besoin d’autrui au sentiment de fraternité envers mon semblable ?
D’un autre côté, la question d’autrui se pose aujourd’hui d’une manière nouvelle : jamais les occasions de communiquer avec notre semblable n’ont été quantitativement aussi nombreuses, alors que jamais probablement les relations réelles établies avec lui n’ont été aussi pauvres. D’abord, les moyens contemporains de communication ont singulièrement réduit les distances : nous pouvons aujourd’hui communiquer « en temps réel » avec des interlocuteurs anonymes habitant aux antipodes. Mais notre voisin de palier, nous l’ignorons peut-être, au point de nous apercevoir de sa présence uniquement quand il déménage… Aussi, les conditions nouvelles de la vie, la vie urbaine nous fait côtoyer chaque jour des centaines de personnes : peut-être plus de gens nouveaux en un mois que nos ancêtres durant toute leur vie. Enfin, on assiste à une « instrumentation» de l’homme dans les relations humaines : nous ressentons souvent l’autre comme moyen par lequel nous pouvons obtenir tel ou tel service, nous ne voyons souvent en lui (et lui en nous) qu’une fonction sociale ou professionnelle, au détriment de l’être global, de sa personne.
Ainsi, si nous faisons un rapide inventaire de ces relations, nous constatons que les plus pauvres sont les plus nombreuses ; ce sont d’ailleurs plus des non-relations, que des relations. Je veux désigner par là le côtoiement quotidien de nos semblables dans la rue, les transports, les lieux publics. Notre principal souci est alors l’évitement : autrui ressenti comme un obstacle physique en mouvement quand je le croise dans la rue, autrui gênant lorsqu’il envahit ma bulle individuelle dans les transports en commun, rival ou concurrent dans une file d’attente aux caisses du supermarché. Notre relation peut aussi être d’utilité, lorsque j’attends de lui un service, lorsque je ne vois en lui que l’agent d’une fonction sociale quelconque, élève, professeur, employé de banque, caissière de grand magasin etc… Le motif de la relation est ici extérieur aux deux sujets, constitué par l’utilité sociale ou économique qui les réunit. Au-delà, nous pouvons aussi considérer les relations inter-individuelles, telles qu’elles sont vécues dans le monde du travail, des loisirs, dans la camaraderie… Dans ce cas également, la relation est motivée par un but extérieur : une activité commune, un centre d’intérêt commun. C’est souvent le hasard qui réunit les individus, il n’y a pas ici de véritable élection. On peut d’ailleurs dire que les relations individuelles réunissent des hommes ou des femmes en fonction de leur ressemblance, au détriment de leur dissemblance : ce qui fait que ces relations sont souvent une négation de leur personne, dans la mesure où on leur demande de laisser en dehors du groupe ce qui constitue précisément leurs choix personnels : opinions politiques, religieuses, choix éthiques etc… C’est dans une moyenne commune que chacun est invité à se fondre. Enfin nous pouvons distinguer un dernier groupe de relations, les relations inter-personnelles (amour, amitié) qui sont caractérisées par une reconnaissance égale de la différence et de la ressemblance et par l’élection : mis à part les relations familiales, qu’on ne choisit pas, l’amitié et l’amour relèvent en grande partie d’un choix.
Mais notre société est aussi caractérisée par une « atomisation » des relations sociales, phénomène qui atteint même les relations familiales. Dans la continuité de l’idéologie communautaire, née avec le mouvement hippie dans les années soixante, on assiste aujourd’hui à l’éclatement de la structure sociale en une multitude de petits groupes ; on pourrait y voir, comme dans les communautés hippie, une volonté de créer des micro- sociétés plus fraternelles fondées sur le partage. Mais en réalité, il s’agit bien souvent d’un phénomène de repli sur soi et de l’enfermement dans des intérêts égoïstes ou sectaires (cf. par exemple les dérives « sécuritaires » pour ne pas dire paranoïaques que l’on constate dans certains « quartiers résidentiels protégés » aux USA). Le signe le plus évident en est l’altération progressive du sens politique, le manque de sens civique, le désintérêt de la chose publique[1]. etc… Même au sein des familles, on constate que les idéaux de réussite individuelle, du « chacun pour soi » prennent le pas sur des valeurs d’amour et d’entraide. Ainsi, les relations permettant l’avènement de la personne ont souvent fait place à celles qui font de l’individu leur nouveau dieu.
Mais qu’entendons-nous précisément lorsque nous parlons de « personne humaine» ? En quoi le concept se distingue-t-il de celui d’Individu ? Nous pouvons revenir à la distinction posée par Kant : la personne est un être raisonnable, considéré comme fin et non comme moyen, qui est une valeur absolue et qui, comme tel, n’a pas de prix :
1. Choses et personnes
L’homme et en général tout être raisonnable existe
comme fin en soi et non uniquement comme moyen utilisable à son gré par telle
ou telle volonté, mais doit, dans toutes ses actions, qu’elles concernent aussi
bien soi-même que d’autres êtres raisonnables, être considéré en même temps
comme fin. Tous les objets des inclinations n’ont qu’une valeur conditionnelle,
car si les inclinations et les besoins qui en dérivent n’existaient pas, leur
objet serait sans valeur. Mais les inclinations mêmes, en tant que sources des
besoins, ont si peu une valeur absolue qui les fassent désirer pour elles-mêmes
que, bien plutôt, en être entièrement libéré doit être le souhait universel de
tout être raisonnable. Ainsi la valeur de tous les objets à acquérir par notre
action est toujours conditionnelle. Les êtres dont l’existence dépend
proprement non de notre volonté mais de la nature n’ont toutefois, si ce sont
des êtres privés de raison, qu’une valeur relative, comme moyens, et c’est
pourquoi on les appelle des choses; au contraire, les êtres raisonnables sont
nommés des personnes parce que leur nature les distingue déjà comme des fins en
sol, c’est-à-dire comme quelque chose qui ne doit pas (darf) être employé
uniquement comme moyen, et par suite, limite d’autant tout arbitraire (et qui
est un objet de respect). Ce ne sont donc pas là des fins uniquement
subjectives, dont l’existence comme effet de notre action a une valeur pour
nous mais des fins objectives, c’est-à-dire dont l’existence est une fin en
soi, et même une fin telle que ne peut être mise à sa place aucune autre fin à
laquelle elle devrait servir uniquement comme moyen, parce que sans cela nulle
part on ne pourrait rien trouver qui eût une valeur absolue, mais si toute
valeur était conditionnelle, et par suite contingente, on ne saurait trouver
nulle part pour la raison un principe pratique suprême.
2. Prix des choses et dignité des personnes
Dans le règne des fins tout
a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut aussi bien être remplacé par
quelque chose d’autre comme équivalent; ce qui, au contraire, est supérieur à
tout prix, qui, par suite, n’admet aucun équivalent, c’est ce qui a une
dignité.
Ce qui se rapporte aux
inclinations et aux besoins humains généraux a un prix marchand; ce qui, sans
supposer de besoin, est conforme à un certain goût, c’est-à-dire à une
satisfaction venant du simple jeu sans but de nos facultés mentales, a un prix
de sentiment; mais ce qui constitue une condition de par laquelle quelque chose
peut être une fin en soi n’a pas uniquement une valeur relative, c’est-à-dire
un prix, mais une valeur intrinsèque, c’est-à-dire une dignité.
Or la moralité est
la condition sous laquelle seule un être raisonnable peut être fin en soi;
parce que ce n’est que par elle qu’il est possible d’être membre législateur
dans le règne des fins. Donc la moralité, et l’humanité en tant qu’elle en est
capable, c’est ce qui seul a de la dignité. L’habileté et l’application au
travail ont un prix marchand; l’esprit, l’imagination vive, l’enjouement ont un
prix de sentiment; au contraire, la fidélité à ses promesses, la bienveillance
selon des principes (et non par instinct) ont une valeur intrinsèque.
KANT
Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785,
2e
section; traduction L.M. Morfaux.
L’être raisonnable, par opposition à l’être sensible, est celui qui dispose d’une autonomie d’action vis à vis de ses penchants naturels, en un mot qui peut choisir en conscience sa vie. Il peut comprendre la situation dans laquelle il vit, peut choisir dans son action les solutions qui lui semblent en accord avec les principes qu’il s’est librement donné, enfin il peut plier sa volonté à ces choix. Rousseau avait dit avant Kant « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté».
Considérer un homme comme une fin et non comme un moyen, c’est en faire la finalité de notre action, telle qu’elle ne peut en disputer avec aucun autre but. Cette distinction est importante, car elle permet de considérer comme violente toute action qui considère autrui comme un moyen, comme une chose dont on peut se servir pour parvenir à ses fins. Si, par exemple, ne ne vois dans l’autre qu’une fonction sociale ou économique, si je dis qu’un élève, ou un prof, en vaut bien un autre, je le réifie[2] . Participe de cette même violence toute réduction de l’autre à l’une de ses dimensions : par exemple la pornographie qui ne voit la femme qu’en tant que corps, ou l’esclavagiste qui ne voit dans l’autre qu’une force de travail
La dignité des personnes et le prix des choses
On peut opposer la dignité au prix selon les critères suivants :
|
Dignité des personnes |
Prix des choses |
|
Être une valeur Absolu Caractère unique Valeur intrinsèque Valeur absolue Universalité Raison |
Avoir un prix Relatif Susceptible d’être échangé Valeur extrinsèque Prix marchand Particularité Sensibilité |
Cette opposition nous permet de bien comprendre ce qui distingue la personne de la chose (et même de la « chose sensible», l’animal). L’autre considéré comme personne c’est l’être unique, celui dont la disparition serait pour nous une perte inestimable, qui peut être remplacé par nul autre. Si nous appliquons ce modèle aux relations d’amour, ou d’amitié, nous comprenons qu’aimer n’est pas qu’une affaire de sensibilité ou inclinations passionnelles. Ces sentiments sont encore de l’ordre de la particularité, de l’ordre de l’ego. Le véritable amour, selon ce schéma commence lorsque l’autre est reconnu aussi en raison comme fin de mon action ; car ici, ce ne sont plus des motivations de mon intérêt propre (qui pourraient, en fin de compte ne relever que de la recherche de mon plaisir), mais l’élection de valeurs universelles qui guident mon action.
Ainsi, le niveau où se jouent des relations véritablement humaines est celui des relations interpersonnelles. Celles-ci supposent la reconnaissance de l’identité, de son originalité, de sa richesse. L’autre n’est plus aimé parce qu’il me ressemble, ou qu’il ressemble à mon désir. Il est aimé pour lui-même pour les qualités et les défauts que je reconnais en lui. Jamais dans les simples relations interindividuelles nous atteignons ce niveau de reconnaissance. Les individus sont les atomes ou les molécules de base de la société. S’individualiser, c’est seulement se distinguer de l’autre, marquer sa frontière par rapport à ce qui n’est pas soi ; de telles relations reposent aussi contradictoirement sur le mythe de la fusion dans le groupe, qui n’est autre chose que l’acceptation de mettre son originalité entre parenthèse au profit du travail collectif ou du loisir commun. Toutes autres sont l’amitié et l’amour : elles supposent la reconnaissance de la différence comme valeur, et non plus seulement comme altérité. Cette différence d’autrui par rapport à moi, c’est la partie de l’être que je n’ai pas, un possible différent du mien qui m’ouvre une nouvelle perspective.
C’est en cela que l’amitié semble à Aristote le plus précieux des biens :
Apprendre à se connaître est très difficile [...] et
un très grand plaisir en même temps (quel plaisir de se connaître!) ; mais nous
ne pouvons pas nous contempler nous-mêmes à partir de nous-mêmes : ce qui le
prouve, ce sont les reproches que nous adressons à d’autres, sans nous rendre
compte que nous commettons les mêmes erreurs, aveuglés que nous sommes, pour
beaucoup d’entre nous, par l’indulgence et la passion qui nous empêchent de
juger correctement. Par conséquent, à la leçon dont nous regardons dans un
miroir quand nous voulons voir notre visage, quand nous voulons apprendre à
nous connaître, c’est en tournant nos regards vers notre ami que nous pourrions
nous découvrir, puisqu’un ami est un autre soi-même. Concluons :la connaissance
de soi est un plaisir qui n’est pas possible sans la présence de quelqu’un
d’autre qui soit notre ami ; l’homme qui se suffit à soi-même aurait donc
besoin d’amitié pour apprendre à se connaître soi-même. »
1 - Le sentiment de
solitude
1.1
Définition
Nous prendrons le soin de distinguer soigneusement l'isolement objectif, du sentiment de solitude. Dans le premier cas il s'agit du fait d'être réellement privé de compagnie ; cette situation ne s'accompagne pas nécessairement du sentiment d'être seul, au contraire, on peut être isolé physiquement de ses proches et cependant continuer à vivre en communion avec eux. Le second cas est indépendant de la situation objective. Il peut se vivre aussi bien dans l'isolement que dans la foule : on pourrait même dire qu'un tel sentiment d'être seul est d'autant plus douloureusement vécu qu'autrui est présent, et que nous ressentons face à lui une impossibilité de communiquer.
Le sentiment de solitude peut donc être défini comme une réaction psychique ; il exprime l'impossibilité de partager notre vie intérieure avec notre semblable. C'est une réaction universelle, mais qui est vécue plus ou moins douloureusement selon les individus.
Il peut sembler curieux de commencer un cours sur autrui en évoquant la souffrance que crée en nous son absence : mais c'est justement là que la nécessité de l'autre pour nous se fait le plus durement sentir, le sentiment de solitude est le révélateur de cette nécessité.
1.2
Approche psychanalytique
C'est à Mélanie Klein[3] que nous emprunterons la première analyse de ce sentiment. Elle en fait remonter l'origine à la petite enfance, dans la toute première relation de la mère à l'enfant. Cette relation est caractérisée par son immédiateté. Cela signifie que les désirs ou pulsions du nourrisson sont d’une part satisfaits sans retard, et surtout, sans médiation. De là une expérience que jamais la vie ne nous offrira par la suite : celle d’être compris sans avoir besoin de recourir à la parole (médiation du langage).
En ce sens, le sentiment de solitude est une nostalgie, un rappel douloureux du passé. Nous regrettons d’avoir souffert d’une perte irréparable : la certitude d’être totalement et immédiatement satisfait.
La première relation mère/enfant agirait comme un modèle sur lequel viendraient ensuite se structurer les relations du futur adulte. De même que ces relations sont originellement clivées entre « la bonne » et la « mauvaise mère » (celle qui est à l’origine soit du plaisir, soit de la souffrance), les relations de l’adulte portent la trace de ce déchirement : l’amour et la haine sont ambivalent, les êtres que nous aimons le plus sont aussi ceux dont nous exigeons le plus, et la jalousie est souvent le pendant naturel de l’amour.
Cependant, pour aussi intéressante qu’elle soit, cette analyse réduit la question du sentiment de solitude à la seule dimension psychologique. Sans doute la renonciation à l’immédiateté de la satisfaction du désir est elle un événement fondateur ; mais d’une part on peut remarquer que cette séparation n’est qu’un avatar[4] d’une série de rupture accompagnant les êtres humains tout au long de leur vie : rupture de la naissance, rupture du sevrage, rupture de l’adolescence, les diverses ruptures qui jalonnent notre vie au fur et à mesure des décès et des séparations, etc… Le thème de la rupture est d’ailleurs constitutif de notre condition :
Qui nous a ainsi retournés ainsi pour que,
quoi que nous fassions, nous soyons dans
l'attitude du départ ? Comme celui qui, de la colline
extrême
contemple encore la vallée tout entière,
comme il s'attarde et se retourne,
ainsi, vivons-nous, en prenant congé sans cesse.
Rainer Maria Rilke, Elégies à Duino,
8e élégie,
1.3 Approche ontologique
Il semblerait que le sentiment de solitude se rapporte au sentiment général d’avoir été coupé, et pas seulement physiquement, au sens du cordon ombilical, pas seulement psychologiquement, au sens du sevrage affectif et intellectuel, mais ontologiquement : coupé, séparé, exilé par rapport à la source de l’être. On peut donner plusieurs interprétations de ce dernier concept.
Le sentiment de solitude se rapporterait alors au sentiment d’être étranger dans un monde qui, à la fois, nous accueille et nous repousse. C’est en particulier la thèse que soutient René Huyghe :
L’homme est jeté dans
l’univers : il est conscience, il ne connaît que lui-même, ou à travers
lui-même. L’univers l’entoure, l’enveloppe, l’assaille, agit sur lui et subit
ses réactions, mais il lui reste inconnu, en dehors de ces rapports pratiques,
parce qu’il est d’une autre nature que l’homme. D’une part, la connaissance que
l’homme a de l’univers ne se réalise vraiment que par la conscience, phénomène
d’ordre totalement immatériel, et cette conscience est vécue par lui comme une
modulation de la durée. Au contraire, l’univers, tel que nous l’atteignons déjà
en notre corps physique, qui nous sert d’intermédiaire, et par nos sens qui
complètent cette relation, se présente en termes d’espace, d’un espace occupé
par la matière, animée elle-même par la vie. D’autre part, la conscience tend à
se confondre avec le moi, qui est l’unité même, puisqu’il vacille dès que cette
unité est ébranlée. L’univers, au contraire, est l’image de la multiplicité
infinie. Deux réalités, qui n’ont donc que des rapports de contingence, se
distinguent, s’affrontent, se heurtent. Tout au plus, le moi présume-t-il, sous
leurs apparences corporelles, l’existence d’autres « moi », analogues à lui et
jetés dans une situation analogue. On pourrait dire que tout se ramène à trois
éléments : le moi, les semblables, qui en même temps sont déjà « les
autres », puis, en face, énorme, écrasant, l’Autre, c’est-à-dire l’univers.
René Huyghe : Les puissances de l’image, Paris Flammarion, 1965, pp. 250-1
Huyghe voit dans la création artistique le seul moyen de vaincre cette solitude ontologique. Nous reviendrons dans le cours sur l’art sur ce thème.[5]
Mais on pourrait aussi dire que cette angoisse d’être exilé dans notre propre monde est à l’origine du sentiment religieux et de la quête d’absolu. Le thème de la chute originelle, que l’on trouve à la fois dans la Bible et dans d’autres religions peut se comprendre comme le fait d’avoir été séparé du regard de Dieu. Dans ces religions Dieu est le Démiurge, la source de l’être dont les hommes se sont originellement détournés. Le retour à Dieu, c’est le retour à cette source dont nous tirons la vie, la réconciliation de l’Esprit jadis dispersé en une unité retrouvée, comme dans la conception hégélienne de l’histoire[6].
Enfin, dans cette solitude, nous remarquons que le seul être qui nous ressemble, c’est notre semblable. C’est avec lui seulement que nous pouvons partager la conscience d’être mortels, la lourde tâche d’être des sujets pensant dans un monde absurde, et l’immense devoir d’avoir à le doter de sens.
Et ma solitude n’attaque pas que l’intelligibilité des choses. Elle mine jusqu’au fondement même de leur existence. De plus en plus, je suis assailli de doutes sur la véracité du témoignage de mes sens. Je sais maintenant que la terre sur laquelle mes deux pieds appuient aurait besoin pour ne pas vaciller que d’autres que moi la foulent. Contre l’illusion d’optique, le mirage, l’hallucination, le rêve éveillé, le fantasme, le délire, le trouble de l’audition... le rempart le plus sûr, c’est notre frère, notre voisin, notre ami ou notre ennemi, mais quelqu’un, grands dieux, quelqu’un !
Miche! Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Gallimard,
1967.
2 - Autrui et la
reconnaissance de soi
Toute conscience est conscience de quelque chose, avions-nous conclu avec Husserl et Sartre dans le cours sur la conscience.[7] Nous avions identifié dans cette citation l’exigence d’intentionnalité, constitutive de la conscience. Nous l’avions définie comme une double exigence, celle d’une relation à quelque chose, ce quelque chose devant être posé comme différent de moi.
Mais qu’en est-il de la conscience de soi ? Car il y a bien relation à un objet, soi ; mais comment pouvons nous satisfaire la seconde exigence, celle de penser l’objet comme différent de soi, comment établir cette distance sujet/objet, puisque moi, c’est moi, que l’objet de la connaissance est aussi le sujet de la connaissance ?
C’est ce que je me propose d’exposer en reprenant l’analyse faites par Sartre, dans « L’être et le néant » à partir de l’exemple de la honte.
Considérons par exemple la honte. […] Sa structure est
intentionnelle, elle est appréhension honteuse de quelque chose et ce quelque
chose est moi. J’ai honte de ce que je suis. La honte réalise donc une relation
intime de moi avec moi : j’ai découvert par la honte un aspect de mon être. Et
pourtant, bien que certaines formes complexes et dérivées de la honte puissent
apparaître sur le plan réflexif, la honte n’est pas originellement un phénomène
de réflexion. En effet quels que soient les résultats que l’on puisse obtenir
dans la solitude par la pratique religieuse de la honte, la honte dans sa
structure première est honte devant quelqu’un. Je viens de faire un geste
maladroit ou vulgaire : ce geste colle à moi, je ne le juge ni ne le blâme, je
le vis simplement, je le réalise sur le mode du pour-soi. Mais voici tout à
coup que je lève la tête; quelqu’un était là et m’a vu. Je réalise tout à coup
toute la vulgarité de mon geste et j’ai honte. Il est certain que ma honte
n’est pas réflexive, car la présence d’autrui à ma conscience, fût-ce à la
manière d’un catalyseur, est incompatible avec une attitude réflexive : dans
le champ de ma réflexion je ne puis rencontrer que la conscience qui est
mienne. Or autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même : j’ai
honte de moi tel que j’apparais à autrui. Et par l’apparition même d’autrui, je
suis en mesure de porter un jugement sur moi-même comme un objet, car c’est
comme objet que j’apparais à autrui. Mais pourtant cet objet apparu à autrui,
ce n’est pas une vaine image dans l’esprit d’un autre. Cette image en effet
serait entièrement imputable à autrui et ne saurait me « toucher ». Je
pourrais ressentir de l’agacement, de la colère en face d’elle, comme devant
un mauvais portrait de moi, qui me prête une laideur ou une bassesse
d’expression que je n’ai pas; mais je ne saurais être atteint jusqu’aux
moelles: la honte
est par nature reconnaissance. Je reconnais que je
suis comme autrui me voit. Il ne s’agit cependant pas de la comparaison de ce
que je suis pour moi à ce que je suis pour autrui, comme si je trouvais en moi,
sur le mode d’être du Pour-soi, un équivalent de ce que je suis pour autrui.
D’abord cette comparaison ne se rencontre pas en nous, à titre d’opération psychique
concrète : la honte est un frisson immédiat qui me parcourt de la tête aux
pieds sans aucune préparation discursive. Ensuite cette comparaison est
impossible : je ne puis mettre en rapport ce que je suis dans l’intimité sans
distance, sans recul, sans perspective du Pour-soi avec cet être injustifiable
et en-soi que je suis pour autrui. Il n’y a ici ni étalon, ni table de
correspondance. La notion même de vulgarité implique d’ailleurs une relation
intermonadique. On n’est pas vulgaire tout seul. Ainsi autrui ne m’a pas
seulement révélé ce que j’étais : il m’a constitué sur un type nouveau qui doit
supporter des qualifications nouvelles. Cet être n’était pas en puissance en
moi avant l’apparition d’autrui, car il n’aurait su trouver de place pour le
Pour-soi ; et même si l’on se plaît âme doter d’un corps entièrement constitué
avant que ce corps soit pour les autres, on ne saurait y loger en puissance ma
vulgarité et ma maladresse, car elles sont des significations et comme telles,
elles dépassent le corps et renvoient à la fois à un témoin susceptible de les
comprendre et à la totalité de ma réalité humaine. Mais cet être nouveau qui
apparaît pour autrui ne réside pas en autrui; j’en suis responsable, comme le
montre bien le système éducatif qui consiste à « faire honte » aux enfants
de ce qu’ils sont. Ainsi la honte est honte de soi devant autrui; ces deux
structures sont inséparables. Mais du même coup, j’ai besoin d’autrui pour
saisir à plein toutes les structures de mon être, le Pour-soi renvoie au pour-autrui.
J.-P. SARTRE, L’être et le néant, Paris, Gallimard, 1943, pp. 275-277.
Remarquons tout d’abord qu’il ne s’agit que d’un exemple : Sartre aurait pu prendre d’autres modes de prise de conscience de soi tels que la fierté, le jugement moral ou même simplement le cogito. La honte est une réaction psychique intéressante en tant qu’elle appartient à notre vécu : ce n’est pas une pensée, résultant d’une réflexion, mais une réaction spontanée que nous éprouvons quand nous nous ressentons en contradiction avec les exigences morales, ou esthétiques qui sont les nôtres. Mais la honte est surtout intéressante car elle est dans son essence contradictoire : d’une part elle est une relation de soi à soi, et cependant elle semble requérir la présence d’autrui. Comment concilier ces deux exigences ? Pourquoi autrui est-il nécessaire à la prise de conscience de ce que je suis ?
2.1
Objectivation
Dans le vécu, je suis sans distance par rapport à moi-même. Je ne suis pas objet vis à vis de moi, mais je suis acteur de ce que je vis. Ainsi, tant que je suis seul, je suis tout au plaisir de ce que je vis, et s’il me plaît de manifester ma joie de vivre par des cris ou une gestuelle que d’aucuns jugeraient grotesque, je le fais sans y trouver à redire. Le regard d’autrui suffit à rompre le charme : en sa présence, je me juge : finie, ma belle liberté car si je suis objet pour quelqu’un, je le deviens pour moi-même. Notons que ce jugement n’est en rien imputable à autrui : autrui est ici seulement un regard, ce n’est pas ce qu’il pense ou ce qu’il dit qui me culpabilise, mais simplement le fait qu’il me regarde, comme je le regarde. Autrui est pour moi objet : je peux le décrire, le juger, le comprendre, etc. Mais lui qui me regarde je sais qu’il peut aussi en faire autant de son côté.
A supposer qu’autrui dise quelque chose, sa parole me pourrait me libérer de ma honte. Je pourrais l’agresser en retour, tourner la scène en plaisanterie, ou m’excuser. Mais son silence m’enferme dans ma honte. Je reconnais que je sui tel qu’autrui me voit, nous dit Sartre. Nous devrions plutôt dire : je reconnais que je suis tel que j’imagine qu’autrui me voit.
Le dernier exemple pris par Sartre, celui de l’enfant, illustre ce thème de la reconnaissance. Si je dis à un enfant qu’il est méchant, il peut bien me retourner le compliment et me dire que c’est moi qui l’est. Je peux aussi le mettre devant la glace, pour l’inciter à regarder sa méchanceté. Mais le miroir[8] ne lui renvoie encore qu’une image trop symétrique pour être « objectivante ». Plus efficace (mais aussi sans doute plus cruel) serait d’opposer à sa conduite celle d’un autre enfant pris comme le modèle : « regarde comme ton petit frère est sage ! » Nous l’incitons donc à prendre le jugement porté sur lui à son compte, la méchanceté n’est plus une vaine image dans l’esprit d’un autre : c’est lui-même qui la reconnaît comme sienne.
2.2
Signification
La notion même de vulgarité implique d’ailleurs une
relation intermonadique[9]. [la] vulgarité et [la] maladresse (…) sont des significations et comme telles, elles dépassent le corps
et renvoient à la fois à un témoin susceptible de les comprendre et à la totalité
de ma réalité humaine
On pourrait en dire autant de la beauté, de la laideur, de l’intelligence ou de la bêtise. Ces qualificatifs n’ont de sens que dans un contexte culturel ou langagier donné, non dans l’absolu. Par exemple, la vulgarité est une norme, conventionnelle et arbitraire. Est vulgaire ici ce qui sera toléré ou même valorisé ailleurs.[10] De même la beauté est, avions nous dit, culturelle[11] : elle n’est beauté qu’à l’intérieur d’un code arbitraire, qu’à l’intérieur d’une même langue.
L’appréciation que je porte sur moi-même renvoie donc à autrui, c’est à dire quelqu’un par qui le mot « vulgaire » a un sens, quelqu’un qui partage avec moi une culture et une langue. On peut dire comme Sartre que l’on n’est pas vulgaire tout seul et, au delà, en le paraphrasant, qu’on n’est pas je tout seul, car « je » est aussi un mot, une signification.
2.3
Reconnaissance
Mais le texte de Sartre ne dit rien de ce dernier concept : celui de la reconnaissance mutuelle de notre humanité. Il n’y a que dans les contes de fées que les miroirs répondent. En d’autres termes, si notre humanité n’est pas entièrement constituée à notre naissance, ni donnée, seul un autre nous-même, une autre conscience peut la reconnaître[12].
Un autre philosophe, Hegel, a développé ce thème au XIXe siècle. Retraçant la genèse de la conscience de soi, il y voit ce mouvement par lequel l’Esprit conquiert le savoir de ce qu’il est et réalise son essence, la liberté. Au fur et à mesure que l’homme s’est éloigné de l’animalité, il s’est progressivement rendu indépendant de ce qui n’était pas lui. Cette indépendance du sujet par rapport à l’objet se réalise lorsque le désir, au lieu de porter sur un objet extérieur porte sur une autre conscience de soi. Retraçons les stades de cette genèse de la conscience de soi, en nous aidant du texte de J. Hyppolite, un commentateur de Hegel :
|
[...] Comment se
présente cette expérience au cours de laquelle je découvre l’indépendance de
l’objet par rapport à moi? On peut dire quelle naît tout d’abord de la
reproduction incessante du désir autant que de l’objet. L’objet est nié et le
désir est assouvi mais alors le désir se reproduit et un autre objet se
présente pour être nié. Peu importe la particularité des objets et des
désirs, cette monotonie de leur reproduction a une nécessité, elle révèle à
la conscience que l’objet est nécessaire pour que la conscience de soi puisse
le nier. « Pour que cette suppression soit, cet autre aussi
doit être »; il y a donc une altérité essentielle du désir en général. Cette
altérité n’apparaît que provisoire pour tel désir particulier, mais son caractère
essentiel résulte de la succession des désirs «c’est en fait un autre que la
conscience de soi qui est l’essence du désir, et par cette expérience, cette
vérité devient présente à la conscience de soi. Jean HYPP0LITE, Genèse et structure de la Phénoménologie de l’Esprit
de Hegel (1946), Aubier, pp. 154-158. |
Sentiment de soi : Dualité
de l’objet visé par le désir : d’une part l’objet sensible (prétexte) d’autre
par la conscience de soi (l’objet
« vrai ») Le
désir est l'essence de la conscience de soi: c'est pourquoi elle ne peut se trouver qu'en désirant un autre désir,
une autre conscience de soi. Sentiment
de soi : Le
sujet perdu dans la "ronde infernale du désir" Altérité
essentielle de la conscience de soi. |
![]()
![]() Commentaire
:
Commentaire
:
2.3.1 Animalité
|
|
Animal Proie besoin |
2.3.2 sentiment
de soi
|
Mais si le sujet découvre ainsi une indépendance par rapport à l’objet (ce n’est plus tel objet sensible qui est l’essence du désir, mais un objet « x », peu importe donc sa particularité) il reste tout de même qu’il faut un objet nouveau pour que le désir se renouvelle. Ainsi nous sommes perdus dans une quête sans fin d’objets nouveaux pour que nous conservions ce sentiment d’exister. Le sentiment de soi n’a aucune stabilité, ce qui en fait un stade élémentaire de la conscience de soi. Le
donjuanisme participe de cette quête. Dom Juan n’aime pas les femmes, il
n’aime pas, comme par exemple Casanova, leur plaisir ; il ne les
considère que comme les emblèmes de sa non-mort : je séduis donc
j’existe, pourrait être sa devise. Tout au plus préférera-t-il une
victime jeune à une femme mûre : la jeunesse lui renvoie en plus la
certitude qu’il n’est pas déjà vieux. Croire à l’amour de l’autre sauverait
Dom Juan du sortilège, en rompant le cycle infernal du renouvellement du
désir et de l’objet. Notons
que ce schéma décrit aussi le processus « consumériste » dans ce
qu’il a de frustration insatisfaite. Je consomme, donc je suis, nous
en sommes bien souvent réduits à être des dom juan de la marchandise :
on a le donjuanisme qu’on peut ! |
Sujet Objet1 désir Sujet Objet2 désir Sujet Objetx désir |
2.3.3 Conscience
de soi : réciprocité de la reconnaissance
Que se passe-t-il si, au lieu de désirer une chose sensible, cet objet du désir est un autre moi-même, une autre conscience de soi ?
Que vise mon désir, sinon précisément le désir de l'autre
: "je t'aime" signifie en même temps à autrui "aime-moi",
non pas que tout désir amoureux soit par essence narcissique, mais parce qu'il
y a une réciprocité essentielle du désir de reconnaissance.

Sujet 1 Désirs Sujet 2
Objet
Les flèches entrecroisées (traits pleins), au centre de l’image, symbolisent le croisement des désirs. Ici le couple sujet/objet cède la place au couple sujet/sujet, comme par exemple dans la relation amoureuse entre un homme et une femme. Que dit ce schéma ? Que chaque sujet désire le désir de l’autre, et non l’autre en tant que corps et promesse d’une jouissance possible (animalité), non comme emblème de notre puissance (cf. plus haut le sentiment de soi et le donjuanisme), mais comme désir de reconnaissance.
Le désir est ici anthropogène, créateur de l’homme : c’est le désir d’autrui qui nous fonde dans notre humanité. Par exemple, la virilité ou la féminité se découvre dans le désir de l’autre. Mais plus largement, nous sommes des êtres humains que parce que nous sommes reconnus comme tels par nos semblables dont nous reconnaissons dans le même temps l’humanité.
Du même coup, notre rapport à l’objet est transformé, il est médiatisé par le désir d’autrui. Notre désir d’un objet quelconque (traits pointillés) passe par son désir « il est humain de désirer ce que désire autrui, parce qu’il le désire » dira un autre commentateur de Hegel, Kojève. Ainsi s’expliquent les phénomènes de mode : un objet sans prix en acquiert un s’il fait l’objet d’une pluralité de désirs.
Mais c’est aussi l’entrecroisement de ces désirs que se font les progrès de l’histoire[13] humaine, L’histoire humaine est l’histoire des désirs désirés. (Kojève)[14]
3
– Pouvoir et
illusion du pouvoir
3.1 –
Illusion du sujet originel
La question est d'abord de savoir ce qui est originel, du sujet ou de la relation entre sujets : pour parler simplement, y a-t-il relations parce qu'il y a d'abord des sujets qui entrent en relation, ou y a-t-il des sujets parce qu'il y a d'abord relation ?
 RELATION
RELATION
?
Sujet
1 Sujet
2
? ?
La première solution semble une évidence : comment peut-on supposer qu'il puisse y avoir un dialogue, s'il n'y a personne pour parler ? Mais c'est une évidence trompeuse. Car nous devons bien reconnaître qu'originellement, lorsque nous venons au monde, nous ne sommes pas déjà des sujets : nous allons le devenir au fur et à mesure que les relations à autrui, en l'occurrence nos parents, vont nous reconnaître et faire advenir cette humanité.
Mais ce n'est pas qu'un problème d'origine. Car tout au long de notre vie, nous pouvons nous rendre compte que ce sont les relations à nos semblables qui nous fondent dans notre humanité et dans notre identité. On peut en donner un contre exemple : nous traversons dans notre vie un certain nombre de crises de l'identité personnelle, crise de l'adolescence, crise de la soixantaine etc… Or, nous constatons que ces moments d'instabilité du moi sont toujours associés à une instabilité relationnelle. La crise de l'adolescence, c'est la rupture d'avec un réseau de relations familiales (affectives, intellectuelles, matérielles) et la constitution d'un nouveau réseau qui va porter notre existence. L'âge de la retraite fait aussi passer les personnes d'un statut social et économique actif, fortement marqué par des relations, à un nouveau statut et à de nouvelles relations. On voit donc que la nécessité de la relation n'est pas seulement celle de l'enfance, celle de la constitution primitive de notre ego, mais que cette nécessité nous accompagne toute notre vie.
On peut donc penser que la relation est la condition de notre existence consciente. Cependant, nous pouvons distinguer deux types de relations : l'une est caractérisée par son immédiateté, l'autre par la médiation du langage.
Désir
Relation médiate (2)
 (langage)
(langage)
![]()
Pulsion
Relation immédate (1)
Sujet 1 Sujet 2
Le premier mode de relation, pulsionnel, appartient à la première enfance : c'est le mode de relation de la mère au nourrisson, comme nous le signalions plus haut. C'est une relation appartient à la période préverbale, et qui est caractérisée par l'immédiateté. L'enfant éprouve un état de tension psychique (faim, besoin d'être changé, angoisses ou douleurs diverses) et le manifeste par des cris ; la mère est celle qui met fin à cet état et apporte à l'enfant un soulagement immédiat. Ce mode de relation est aliénant pour la mère que l'enfant, tel un petit tyran, prétend avoir à sa disposition sans partage.
Dans le second mode de relation, l’enfant renonce à l’immédiateté de la satisfaction du désir et accepte la médiation du langage. Au lieu d’exprimer ses pulsions, il va dire ses désirs. Ce passage par le langage enlève à la pulsion son caractère particulier et lui donne la marque de l’universel : elle se fait désir, qui s’exprime dans un langage. Mais si l’enfant subit une perte, celle d’être totalement et immédiatement satisfait, il gagne en retour la reconnaissance de son humanité : le langage est ce terrain d’entente où les êtres humains se reconnaissent mutuellement, car ils sont les seuls à parler. L’enfant découvre alors progressivement son moi, et l’accès à la conscience est contemporain de cet apprentissage de la langue[15].
Mais ces deux modes relationnels subsistent à l’âge adulte : devenu grâce au second des sujets conscients de notre individualité et de notre intérêt propre, nous continuons bien souvent à investir le premier mode de relation, en mettant en scène les autres comme des objets, oubliant précisément ce que nous leur devons pour être. En fait, bien que produits de la relation à autrui, et ne pouvant exister sans eux, nous nous conduisons souvent comme si nous étions des sujets originels, se suffisant à eux-mêmes pour être.
Cette contradiction est d’autant plus facile à ignorer que nous sommes des « nantis de la relation ». Je veux dire par là que nous pouvons nous payer le luxe de ne pas reconnaître parfois autrui comme une personne, dans la mesure où, par ailleurs, dans d’autres relations, nous sommes nous mêmes reconnus. Ainsi la nécessité d’autrui pour nous n’apparaît généralement pas comme cruciale et nous pouvons nous autoproclamer maîtres et souverains de notre citadelle intérieure.
Le problème serait radicalement différent si nous venions à manquer d’autrui. C’est l’intérêt des « robinsonnades » de créer fictivement un univers d’où autrui aurait disparu. La situation de Robinson Crusoé[16] nous servira donc d’exemple. Après avoir cruellement ressenti combien l’absence d’autrui le menait inexorablement à la perte de son humanité, Robinson finit par rencontrer Vendredi, dont il fait d’abord son esclave. Voici Robinson libéré du travail nécessaire, Vendredi produit pour lui richesse et confort. Robinson va d’abord découvrir ce que cet accroissement de richesse a d’absurde dans une situation où le commerce et les échanges n’existent pas : ses greniers pleins, qui vaudraient de l’or en Angleterre sont ici inutiles car une fois satisfaits ses besoins et ceux de son serviteur, on ne sait plus que faire du surplus. Robinson décide donc d’affranchir Vendredi, qui d’esclave devient travailleur libre et salarié ; désormais il achètera nourriture et loisir à l’aide de son salaire. Faire de Vendredi un agent économique crée bien un marché dans l’île, mais ne résout pas la question de la renaissance et de la reconnaissance de l’humanité de Robinson. Pour cela il faudrait que Vendredi soit reconnu comme personne. Robinson le réalisera lorsqu’il acceptera de recevoir de Vendredi les leçons d’un art de vivre antillais, c’est à dire lorsqu’il reconnaîtra son humanité comme au moins égale à la sienne.
Robinson n’a pas le choix : c’est autrui ou la mort. Avons-nous plus le choix, hormis que le problème ne se pose pas pour nous de manière aussi cruciale ?
Mais dans ce cas la question du pouvoir que nous allons aborder à présent ne serait qu’une illusion : exercer un pouvoir sur autrui serait la conséquence d’une illusion première : celle de croire que nous pouvons exister sans lui. Sera-ce encore un problème moral ?
3.2 –
Volonté de puissance ou désir de domination
3.2.1 Calliclès
et le désir de domination
Car comment un homme pourrait-il être heureux s'il
est esclave de quelqu'un d'autre? Veux- tu savoir ce que sont le beau et le
juste selon la nature ? Hé bien, je vais te le dire franchement ! Voici, si on
veut vivre comme il faut, on doit laisser aller ses propres passions, si
grandes soient-elles, et ne pas les réprimer. Au contraire, il faut être capable de mettre son courage
et son intelligence au service de si grandes passions et de les assouvir avec
tout ce qu'elles peuvent désirer. Seulement, tout le monde n'est pas capable,
j'imagine, de vivre comme cela. C'est pourquoi la masse des gens blâme les
hommes qui vivent ainsi, gênée qu'elle est de devoir dissimuler sa propre
incapacité à le faire. La masse déclare donc bien haut que le dérèglement—j'en
ai déjà parlé—est une vilaine chose. C'est ainsi qu'elle réduit à l'état
d'esclaves les hommes dotés d'une plus forte nature que celle des hommes de la
masse; et ces derniers, qui sont eux-mêmes incapables de se procurer les
plaisirs qui les combleraient, font la louange de la tempérance et de la
justice à cause du manque de courage de leur âme. Car, bien sûr, pour tous les
hommes qui, dès le départ, se trouvent dans la situation d'exercer le pouvoir,
qu'ils soient nés fils de rois ou que la force de leur nature les ait rendus
capables de s'emparer du pouvoir—que ce soit le pouvoir d'un seul homme ou
celui d'un groupe d'individus, oui, pour ces hommes-là, qu'est-ce qui serait
plus vilain et plus mauvais que la tempérance et la justice ? ce sont des hommes qui peuvent jouir de
leurs biens, sans que personne y fasse obstacle, et ils se mettraient eux-mêmes
un maître sur le dos, en supportant les lois, les formules et les blâmes de la
masse des hommes I Comment pourraient-ils éviter, grâce à ce beau dont tu dis qu'il est fait de justice et de
tempérance, d'en être réduits au malheur, s'ils ne peuvent pas, lors d'un
partage, donner à leurs amis une plus grosse part qu'à leurs ennemis, et cela,
dans leurs propres cités, où eux-mêmes exercent le pouvoir ! Écoute, Socrate, tu prétends que tu
poursuis la vérité, eh bien, voici la vérité: si la facilité de la vie, le
dérèglement, la liberté de faire ce qu'on veut, demeurent dans l'impunité, ils
font la vertu et le bonheur ! Tout le reste, ce ne sont que des manières, des
conventions, faites par les hommes, à l'encontre de la nature. Rien que des
paroles en l'air, qui ne valent rien !
Platon, Gorgias
Calliclès est, dans le Gorgias de Platon, l’un des trois interlocuteurs de Socrate. Celui-ci vient d’affirmer une thèse qui est scandaleuse aux yeux de Calliclès : qu’il vaut mieux être puni injustement que de commettre l’injustice sans être puni. Cela donne lui donne l’occasion de faire ici l’apologie du pouvoir fort, qui ne peut connaître de limite que celle de son appétit et de son courage.
La thèse de Calliclès s’appuie sur trois arguments :
- un argument naturaliste : la vertu selon la nature est de donner à ses désirs leur maximum de réalisation, sans imposer de limite à son appétit de jouissance
- La tempérance et la morale sont des invention des faibles pour asservir les forts : les moralistes sont des impuissants et des lâches car ils n’osent ni ne peuvent réaliser leurs désirs
- Si la nature, la naissance, la chance nous offrent l’occasion de jouir de la vie, on ne peut concevoir pourquoi nous imposerions des limites à notre jouissance, qui feraient de nous des esclaves et nous laisseraient sans armes contre nos adversaires.
La dernière phrase, en caractères gras, résume sa position.
Que répondrons nous à Calliclès ?
Nous ne pouvons évidemment pas recourir à une morale déjà instituée (par exemple la morale chrétienne), car il nous la renverrait : ce serait notre morale, non la sienne, et nous risquerions fort de nous entendre dire que nous aussi nous faisons partie du complot des faibles !
Nous pourrions à notre tour lui faire remarquer qu’il fonde son opinion sur une cause contingente : la chance, la naissance, la nature, autant de faits qui pourraient aussi bien ne pas être. Il nous rétorquerait sans doute, « raison de plus pour en profiter, si la force ne dure pas, tant qu’elle est là servons-nous en pour profiter de la vie.
Nous pourrions enfin lui faire remarquer qu’en instituant une hiérarchie des forts et des faibles, il ne nous assure pas du tout que l’excellence est partagée comme la force : le plus fort est-il nécessairement le meilleur ? Question bonne à agiter par des esclaves entendus par leur maître dira Rousseau, mais qui ne convient pas à un homme libre. Ici nous marquerions des points, car l’asservissement dont parle Calliclès n’est que celui de la force, non celui des talents. Il lui resterait toujours la possibilité de nous répondre avec arrogance et cynisme, à la manière de Bismarck, que la force prime le droit, ou à la manière du loup de la fable, que la raison du plus fort est toujours la meilleure.[17]
Quelle est la réponse de Socrate à Calliclès ?
Il lui fera remarquer tout d’abord que le plus grand des malheurs, pour celui qui prétend jouir de son prochain n’est pas tant dans le caractère mauvais de cette action que dans le fait qu’elle reste impunie. Certes le plaisir est bon, mais il ne vaut pas qu’on lui sacrifie une occasion d’être juste en payant pour ses fautes. Ainsi Calliclès s’il meurt impuni restera éternellement débiteur de l’idéal du juste.
Mais c’est surtout la vanité du pouvoir au regard de la problématique de l’être qui constitue pour Socrate le plus grand malheur. La vie de jouissance que prône Calliclès n’est pas une vie selon l’être, mais une vie selon l’avoir. Une vie de pluvier dira Socrate, une vie où l’on mange et fiente en même temps. Tel le tonneau des Danaïdes, la vie de Calliclès est un vase sans fond, où le plaisir passe sans former de l’être. Enfin, par le mythe du jugement des âmes, Socrate tentera de faire comprendre à son jeune adversaire qu’une âme trop chargée d’avoir, de richesses et de puissance terrestres ne peut se présenter nue : elle n’aura pas la légèreté requise pour s’envoler vers sa patrie, le monde des idées. Trop adhérente à la matière et aux plaisirs charnels, elle subira le pire des sorts attendant l’âme pour Platon : elle se réincarnera, elle retombera dans une nouvelle prison de chair.
3.2.2
Critique rousseauiste du droit du plus fort
Le plus fort n’est-
jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en
droit, et l’obéissance en devoir. De là le droit du plus fort, droit pris
ironiquement en apparence, et réellement établi en principe. Mais ne nous
expliquera-t-on jamais ce mot? La force est une puissance physique; je ne vois
point quelle moralité peut résulter. de ses effets, Céder à la force est un
acte de nécessité, non de volonté; c’est tout au plus un acte de prudence. En
quel sens pourra-ce être un devoir ?
Supposons
un moment ce prétendu droit. Je dis qu’il n’en résulte qu’un galimatias
inexplicable; car, sitôt que c’est la force qui fait le droit, l’effet change
avec la cause : toute force qui surmonte la première succède à son droit.
Sitôt qu’on peut désobéir impunément, on le peut légitimement; et, puisque le
plus fort a toujours raison, il ne s’agit que de faire en sorte qu’on soit le
plus fort. Or, qu’est-ce qu’un droit qui périt quand la force cesse? S’il faut
obéir par force, on n’a pas besoin d’obéir par devoir; et si l’on n’est plus
forcé d’obéir, on n’y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit
n’ajoute rien à la force; il ne signifie ici rien du tout.
Obéissez
aux puissances. Si cela veut dire cédez à la force, le précepte est bon, mais
superflu; je réponds ‘qu’il ne sera jamais violé[18].
Toute puissance vient de Dieu, je
l’avoue ; mais toute maladie en vient aussi : est-ce à dire qu’il soit défendu
d’appeler le médecin? Qu’un brigand me surprenne au coin d’un bois, non
seulement il faut par force donner sa bourse; mais, quand le pourrais la
soustraire, suis-je en conscience obligé de la donner? Car, enfin, le pistolet
qu’il tient est une puissance.
Convenons donc que force ne fait pas droit, et
qu’on n’est obligé d’obéir qu’aux puissances légitimes. Ainsi ma question
primitive revient toujours.
Rousseau, Le Contrat Social L. 1, Chap. III. — Du droit du plu fort.
Toute autre est la critique de Rousseau, elle se développe sur trois fronts :
- C’est d’abord une critique sur la nature du concept du « plus fort » : l’expression est un superlatif, qui induit une référence ; faute de pouvoir être le plus fort absolu –sauf bien entendu à se prétendre Dieu, pas que n’hésiteront pas à franchir nombre de tyrans- ils ne sont les plus forts que relativement à d’autres : le plus fort n’est jamais assez fort, et risque à tout moment de tomber sur plus fort que lui.
- D’autre part la force est disqualifiée dans sa prétention à servir de fondement au droit car elle est éphémère, elle ne repose que sur ses moyens, qui peuvent aussi bien changer de mains. Or, qu’est-ce qu’un droit qui périt quand la force cesse? Si la force est caduque, elle ne peut donc fournir au droit fondement stable.
- Mais la critique la plus radicale opérée par Rousseau est une critique de type linguistique ou sémantique : le droit du plus fort est une « expression mal formée », un galimatias[19] inexplicable. On peut réaliser un inventaire des contradictions de sens caractéristiques de cette expression :
Force
|
Droit |
|
Obéissance Puissance physique Acte de nécessité tout au plus de prudence Impunité Obéir par force Etre forcé Puissance des armes |
Devoir Moralité Acte de volonté Légitimité Obéir par devoir Etre obligé[20] Puissance légitime |
On remarque que les deux concepts s’opposent terme à terme : ils sont mutuellement incompatibles. «Le droit du plus fort » est une crase[21], l’union contre nature de deux univers, celui de la nécessité et celui de la volonté, celui de la nature et celui de la moralité ; impunie, la force se croit légitime, et usurpe le nom de loi.
3.2.3 De
l’impuissance du désir de domination à la création de la volonté de puissance
Nous entendons par désir de domination l’affirmation de soi par l’asservissement de l’autre, dans un tel désir je ne m’affirme que par la négation de l’autre, et non positivement, par ce que je suis moi-même ; plus encore, celui qui désire dominer reconnaît par là même qu’il ne domine pas encore : le désir de domination est le fait d’un envieux.
La volonté de puissance est un concept emprunté à Nietzsche, chez qui il désigne l’affirmation de la puissance en tant que capable de créer des valeurs ; la volonté de puissance remonte du vivant jusqu’à l’homme comme force vitale, dionysiaque : c’est celle qui pousse la vie à occuper le plus grand espace, comme c’est elle qui pousse l’artiste à créer. La volonté de puissance est donc positive et créatrice, elle trouve sa justification en elle-même, et si, incidemment, elle domine, cette domination n’est pas pour elle en soi une finalité, ce qu’elle est dans le cas précédemment étudié.
Nous retrouvons ce dualisme dans le concept de pouvoir : il est à la fois « capacité de » (positive) et « domination sur » (négative). Cette distinction nous permet de repérer deux types d’hommes et d’en déduire une conception de la relation vertueuse à autrui.
|
|
Le
tyran tout d’abord, cet Iznogoud si bien nommé (par Gosciny) Etymologiquement, celui qui n’est pas bon et qui, faute de pouvoir créer, ou aimer, choisi de détruire et de dominer. La tyrannie est d’abord un aveu d’impuissance, celle de ne pouvoir se définir positivement ; sa devise est : Las de se faire aimer, il veut se faire craindre[22]Le
tyran se croit libre : en fait il est l’avatar le plus représentatif de
l’esclavage, dans la mesure où il se définit comme un envieux, un homme qui
aspire à la puissance parce qu’il a reconnu son impuissance ; il est
l’esclave de l’homme libre, qu’il jalouse L’homme libre n’est point envieux, il admet
volontiers ce qui est grand et sublime et se réjouit que cela soit.[23] C’est un homme désespéré, dans la mesure où il a cessé de croire en lui-même, et au-delà en l’homme. Il
a choisi sa mort : son existence, vouée au seul culte de son bon
plaisir, est absurde dans la mesure où ce qui disparaîtra avec sa mort, c’est
précisément ce qui faisait son plaisir de vivre. |
|
|
Le
philosophe ensuite, et leur père à tous, Socrate Il
se manifeste d’abord dans un refus de dominer, et préfère être réfuté plutôt
que de convaincre par la violence. Eh bien, je suis quelqu'un qui est content d'être
réfuté, quand ce que je dis est faux, quelqu'un qui a aussi plaisir à réfuter
quand ce qu'on me dit n'est pas vrai, mais auquel il ne plaît pas moins
d'être réfuté que de réfuter.[24] La
relation à son semblable est amicale et à pour but l’avènement de son être et
la recherche de la vérité : Voyons, Calliclès, y a-t-il déjà un citoyen que tu
aies amélioré ? Y a-t-il un homme qui, avant de rencontrer Calliclès était un
homme méchant, injuste, déréglé, déraisonnable et qui, grâce à lui, soit
devenu homme de bien ?24 On ne parle plus aujourd’hui de ceux qui ont injustement condamné Socrate à mort, alors que sa philosophie ne cesse de nous interpeller et de nous aider à comprendre notre vie. La création permet au philosophe de vivre au-delà de sa mort |
|
|
L’archétype de la volonté de puissance, c’est l’artiste. Van Gogh n’a jamais désiré établir une domination sur quiconque. Dernier des derniers, sa peinture ne fut pas reconnue de son temp. Et cependant la puissance de son œuvre a traversé le temps : elle nous parle encore aujourd’hui. C’est
dire qu’une telle œuvre était le reflet d’une force créatrice que
probablement son auteur ne maîtrisait pas lui-même. Contre
la critique de son temps, contre la peinture officielle, celle du pouvoir et
des notables se dresse le génie créateur d’un homme humble mais qui tirait
son aspiration du plus profond de sa souffrance. |
Ainsi, la conquête de notre humanité passe par une renonciation : celle des illusions d’une vie entièrement vouée à l’épanouissement et à la glorification de notre ego. Dans le même temps nous devons renoncer à voir dans autrui le moyen de l’assouvissement de nos désirs. Par quoi il faut comprendre que notre être n’est pas en nous, ni dans l’asservissement de l’autre, mais dans la création hors de nous, et en commun avec les autres.
3.3 –
Amour de soi et amour de l'autre : l’insociable sociabilité.
Il reste que cette relation de moi à autrui est marquée par un tragique déchirement : la contradiction, que Rousseau avait su décrire comme irréductible entre la nécessité d’autrui pour nous, et la découverte de notre intérêt propre, de notre amour propre.
Nous sommes partagés, déchirés entre cette double exigence : la vie sociale, les échanges avec autrui nous font découvrir notre moi, et avec lui, que nous avons des intérêts différents des siens, voire opposés aux siens. La reconnaissance de soi entraîne une exigence de considération à laquelle nul ne veut renoncer. Rousseau, dans le discours sur l’origine de l’inégalité, a admirablement synthétisé ce point[25]
Sitôt que les hommes eurent commencé à s’apprécier
mutuellement, et que l’idée de la considération fut formée dans leur esprit,
chacun prétendit y avoir droit, et il ne fut plus possible d’en manquer impunément
pour personne. De là sortirent les premiers devoirs de la civilité, même parmi
les sauvages ; et de là, tout tort volontaire devint un outrage, parce
qu’avec le mal qui résultait de l’injure l’offensé y voyait le mépris de sa
personne, souvent plus insupportable que le mal-même.[26]
Kant reprendra cette opposition sous le concept d’insociable sociabilité à la fois source du désordre social et ferment du progrès historique25
Mais ce déchirement tragique n’est pas seulement une faille de notre condition. Il est aussi ce qui permet la découverte de la moralité, ou du moins de l’interrogation morale. Puisque autrui est comme moi « une liberté posée en face de moi, qui ne pense, et qui ne veut que pour ou contre moi[27] » (et moi pour ou contre lui), je découvre en sa présence que mon existence sera une succession de choix moraux, partagée entre l’amour de moi et le respect de l’autre, et une volonté tendue vers la conciliation jamais achevée de l’un et l’autre.
CONCLUSION
Nous nous posions, en introduction à ce cours, la question de savoir si autrui était pour moi une nécessité ou une question morale. Nous avions noté que les deux réponses s’excluaient mutuellement.
Or nous découvrons à l’issue de ce parcours que les deux exigences sont inséparables. Autrui est à la fois une nécessité pour moi, je ne puis être moi même sans lui, et il est aussi un problème moral, puisque nous sommes deux libertés posées face à face, et dont chacune veut à la fois servir son intérêt propre et aimer l’autre.
Comment formuler plus simplement ce dilemme ? Peut-être en disant simplement si nous ne pouvons vivre sans autrui, nous ne voulons pas vivre sous autrui.
Michel Le Guen 25/01/2001



