
LA VERITE
Introduction
On peut tenter dans un premier temps d’expliciter le champ sémantique de la notion, en particulier en envisageant les divers antonymes qui s’y opposent :
Vrai
|
|
Faux
|
||
|
Question éthique La morale : Que dois-je
faire ? |
|
|
Mensonge |
Illusion Chimère Fantasme Apparence |
|
Question épistémologique : La connaissance Que puis-je
connaître ? |
Validité |
VERITE |
Erreur |
|
|
Question ontologique & métaphysique : La croyance Que m’est-il donné
d’espérer ? |
Certitude |
|
Incertitude (doute) |
|
Ainsi, tout semble clair : une opposition entre le positif et le négatif, un dualisme simple se déclinant autour des trois questions de Kant : que dois-je faire ? (problématique morale du mensonge ou de la franchise), que puis-je connaître, (problématique de la connaissance ou de l’erreur) et enfin que m’est-il donné d’espérer (problématique de la croyance, de la certitude ou du doute.)
Mais, passée la première impression rassurante que donnent les idées claires et distinctes, quand elles acceptent d’entrer dans les catégories du jugement où nous voudrions les installer, passée la satisfaction d’avoir rendu compte d’un problème complexe par une topique éclairante, qui ne perçoit les insuffisances d’une telle classification ?
En effet, cette dichotomie suppose qu’une distinction nette puisse être établie entre les domaines du faux et du vrai. Elle postule implicitement qu’il existerait une vérité absolue, et un mensonge absolu. Or, nous pourrions démontrer, à la suite de Brice Parrain, que la vérité ou le mensonge sont toujours de l’ordre du relatif. La vérité s’exprime pour nous sous diverses formes : chacune d’entre elles est partielle, mais aucune n’épuise le sens de ce qu’il y aurait à dire. Sauf à considérer un usage ludique du mensonge, un mensonge immotivé en quelque sorte, tout mensonge comporte toujours une part de vérité : on ne ment pas sans raisons et sous le travestissement du discours, on pourrait retrouver dans les motivations du menteur, une vérité cachée qui le pousse à mentir.
Parmi les mots qui sont à notre disposition et qui appartiennent en
commun à tous, chacun saisit ceux qui lui conviennent pour se présenter. Je dis
que j’ai faim. Un autre aurait dit qu’il avait mal à la tête, un autre qu’il
était fatigué, un autre se serait
agacé d’un contretemps (...). Un autre encore assurerait qu’il n’a pas du tout
faim. Vous surprenez votre enfant au milieu de la matinée devant l’armoire à
provisions. II vous réplique qu’il ne sait pas au juste ce qu’il cherche mais
qu’il n’a pas faim. Et, en effet, il n’a pas faim, car il ne s’est pas dit
qu’il avait faim, il est venu là, il a ouvert l’armoire, il aurait, sans doute,
croqué un morceau de sucre ou un gâteau sec, ou une pomme. Cela s’appelle-t-il
avoir faim? Chacun
de ces
personnages aurait eu raison, essayant, selon ses goûts et les habitudes de son
milieu, d’exprimer ce qu’il ressentait le plus vivement et surtout ce qui
répondait le mieux à ses préoccupations ou à son tempérament. Mais en même
temps personne n’aurait dit la vérité, parce que la vérité, dans ce cas, serait
ce qui le mieux remédierait au trouble de chacun et que chacun ignore (...).
Cela s’appelle-t-il du mensonge? A juger strictement, il faut penser, comme
PLATON, que le menteur est celui qui connaît la vérité et la dissimule sous un
autre dehors. En est-il des cas? Il n’y a pas plus de mensonge pur que de
vérité pure. Nier ce qui est en paraît un. Mais ce n’est encore qu’un
demi-mensonge. Pour 1e mer tout à fait, il faudrait plus que le
passer entièrement sous silence, ce qui est rare déjà, il faudrait le détruire,
ce qui n’est pas en notre pouvoir. Mal dire une chose c’est ouvrir un débat au
cours duquel elle sera bien dite; ne pas la dire c’est provoquer quelqu’un à la
faire. Le menteur n’exprime qu’un possible différent de celui qui s’est
réalisé, mais qui aurait pu se réaliser pourtant, et qui, même, aurait dû se
réaliser selon lui, qui en tout cas sera jugé puisqu’il est accusé. Lorsque ma fille
me dit qu’elle a fait son devoir, alors qu’elle ne l’a pas fait, ce n’est pas
pour m’induire en erreur, ce n’est pas avec le dessein de m’induire en erreur,
c’est pour me signifier qu’elle aurait pu le faire, qu’elle avait envie de le
faire, qu’elle aurait dû le faire et que tout cela n’a pas d’importance; c’est
donc plus pour se débarrasser d’un fâcheux que pour parler à faux. Or se
débarrasser, pour elle, est un acte vrai, puisqu’elle en ressent le besoin. Le
moyen importe-t-il et devons-nous être soumis à ce supplice de choisir celui
qui est le plus proche de la vérité sans néanmoins l’atteindre, puisqu’il n’en
est aucun d’absolument vrai pour personne, puisque la vérité nous échappe, bien
que nous ne cessions pas de la produire?
Brice PARAIN,
Recherches sur la nature et les
fonctions du langage,
Éditions Gallimard, « Idées
», 1942.
D’autre part, nous pouvons remarquer en étudiant la notion d’illusion, que la séparation du vrai et du faux n’est pas aussi nette qu’il le semblait : en effet, si la chimère semble être le degré extrême de l’erreur, il n’en va pas de même pour l’apparence, comme nous le verrons ci-après. S’il est des apparences trompeuses, d’autres encore sont pour nous les manifestation du vrai. Les fictions sont-elles des mensonges ? Certes le romancier crée un monde fictif, issu pour une bonne part de son imagination. En quel sens est-ce un mensonge ? Il nous faudra étudier la fonction particulière du paradoxe, dont on peut ne retenir que le caractère contradictoire, mais dont on peut aussi bien dire, en anticipant de notre propos, qu’il est aussi pour nous le révélateur d’un sens caché.
Et que dire de l’opinion, ce pseudo-savoir qui prétend être vrai ? En quoi peut-il être à la fois une connaissance, et ce qui empêche la connaissance ?
Toutes ces questions nous
montrent combien la problématique de la vérité ne se réduit à pas à opposer le
vrai et le faux. De cette hésitation nous tirerons notre question : Si la vérité en tant qu'absolu n'est pas
accessible aux êtres humains, ne doit-on pas en développer une conception
dynamique, qui la représente en tant que processus en marche, en tant que
recherche indéfinie[1] du sens ?
Nous devrons tout d'abord montrer que la recherche de la vérité est bien plus qu'une conquête sur le non-savoir (entendu comme le manque de connaissances) une lutte contre le pseudo-savoir, contre les mirages de l'opinion.
Aussi, en posant la question de la "vérité dans l'art", nous nous demanderons en quoi l'œuvre d'art peut être à la fois une apparence et une révélation de ce que nous ne percevons pas habituellement dans le réel.
Enfin, nous poserons la question délicate du rapport du discours des sciences et de la vérité: Quelles en sont les limites ? Doit-on parler de vérité ou de validité des théories scientifiques? La science ne doit-elle pas renoncer à atteindre une vérité dogmatique, un état définitif du savoir ?
1 – Doxa[2] et paradoxe : La recherche de la vérité comme lutte contre le pseudo-savoir.
1.1 - La reconnaissance du manque
Aucun des dieux ne philosophe et ne désire devenir savant, car il l'est: et, en général. si l'on est savant. on ne philosophe pas: les ignorants non plus ne philosophent pas et ne désirent pas devenir savants: car l'ignorance a précisément ceci de fâcheux que, n'ayant ni beauté, ni bonté, ni science, on s'en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas.
Platon, Le Banquet, 203 c, trad. Chambry, 1964, Garnier‑Flammarion,
p. 65.
Platon
nous invite à distinguer deux types d’ignorance. L’une, l’absence de
connaissances l’autre le pseudo-savoir. Or, le manque de connaissance n’est pas
pour lui l’ignorance véritable. La reconnaissance de ce manque est même le
début du processus de connaissance. Pourquoi les Dieux ne désirent-ils pas
devenir savant ? Parce qu’ils sont omniscients. Du jeune esclave du Ménon,
Socrate n’exige que deux choses :
qu’il sache le grec, et d’autre part qu’il accepte, contrairement à son maître
Ménon, de reconnaître son manque primitif de savoir. A partir de cette
reconnaissance initiale, et par la seule vertu du dialogue, le jeune
homme, dont l’inculture mathématique est pourtant avérée, va calculer avec
Socrate quelle est la longueur du côté d’un carré dont l’aire est le double
d’un carré donné[3]. L’ignorant
véritable est donc celui qui croit savoir et non pas celui qui ne sait pas,
celui à qui l’opinion tient lieu de science.
Mais
qu’est-ce que l’opinion ? En quoi devons nous la reconnaître comme le
principal obstacle dans notre recherche de la vérité ? La lecture de
l’allégorie de la caverne nous aidera à cerner ce concept :
1.2 - L’allégorie
de la caverne
Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine,
en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la
lumière; ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés,
de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne
les empêchant de tourner la tête; la lumière leur vient d'un feu allumé sur une
hauteur, au loin derrière eux; entre le feu et les prisonniers passe une route
élevée: imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil
aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et
au-dessus desquelles ils font voir leurs merveilles.
Je vois cela, dit-il.
Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des
hommes portant des objets de toute sorte, qui dépassent le mur, et des
statuettes d'hommes et d'animaux, en pierre, en bois, et en toute espèce de
matière; naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se
taisent.
Voilà, s'écria-t-il, un étrange tableau et
d'étranges prisonniers.
Ils nous ressemblent, répondis-je; et d'abord,
penses-tu que dans une telle situation ils aient jamais vu autre chose
d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la
paroi de la caverne qui leur fait face ?
Et comment ? observa-t-il, s'ils sont forcés de
rester la tête immobile durant toute la vie ?
Et pour les objets qui défilent, n'en est-il pas de
même ?
Sans contredit.
Si donc ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne
penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils
verraient ?
Il y a nécessité.
Et si la paroi du fond de la prison avait un écho,
chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croiraient-ils entendre autre
chose que l'ombre qui passerait devant eux ?
Non, par Zeus, dit-il.
Assurément, repris-je, de tels hommes n'attribueront
de réalité qu'aux ombres des objets fabriqués.
C'est de toute nécessité.
Considère maintenant ce qui leur arrivera
naturellement si on les délivre de leurs chaînes et qu'on les guérisse de leur
ignorance. Qu'on détache l'un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser
immédiatement, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière;
en faisant tous ces mouvements il souffrira, et l'éblouissement l'empêchera de
distinguer ces objets dont tout à l'heure il voyait les ombres. Que crois-tu
donc qu'il répondra si quelqu'un lui vient dire qu'il n'a vu jusqu'alors que de
vains fantômes, mais qu'à présent, plus près de la réalité et tourné vers des
objets plus réels, il voit plus juste ? si, enfin, en lui montrant chacune des
choses qui passent, on l'oblige, à force de questions, à dire ce que c'est ? Ne
penses-tu pas qu'il sera embarrassé, et que les ombres qu'il voyait tout à
l'heure lui paraîtront plus vraies que les objets qu'on lui montre maintenant ?
Beaucoup plus vraies, reconnut-il.
Et si on le force à regarder la lumière elle-même,
ses yeux n'en seront-ils pas blessés ? n'en fuira-t-il pas la vue pour retourner
aux choses qu'il peut regarder, et ne croira-t-il pas que ces dernières sont
réellement plus distinctes que celles qu'on lui montre ?
Assurément.
Et si, repris-je, on l'arrache de sa caverne par
force, qu'on lui fasse gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne le lâche
pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, ne souffrira-t-il pas
vivement, et ne se plaindra-t-il pas de ces violences ? Et lorsqu'il sera parvenu à la lumière
pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une seule des
choses que maintenant nous appelons vraies ?
Il ne le pourra pas, répondit-il; du moins dès
l'abord.
Il aura, je pense, besoin d'habitude pour voir les
objets de la région supérieure. D'abord ce seront les ombres qu'il distinguera
le plus facilement, puis les images des hommes et des autres objets qui se
reflètent dans les eaux, ensuite les objets eux-mêmes. Après cela, il pourra,
affrontant la clarté des astres et de la lune, contempler plus facilement
pendant la nuit les corps célestes et le ciel lui-même, que pendant le jour le
soleil et sa lumière.
Sans doute.
A la fin, j'imagine, ce sera le soleil—non ses
vaines images réfléchies dans les eaux ou en quelque autre endroit—mais le
soleil lui-même à sa vraie place, qu'il pourra voir et contempler tel qu'il
est.
Nécessairement, dit-il.
Après cela il en viendra à conclure au sujet du
soleil, que c'est lui qui fait les saisons et les années, qui gouverne tout
dans le monde visible, et qui, d'une certaine manière, est la cause de tout ce
qu'il voyait avec ses compagnons dans la caverne.
Évidemment, c'est à cette conclusion qu'il arrivera.
Platon, La République, Livre VII, trad. Baccou,
Éd. Garnier.
Le
mythe de la Caverne nous fournit une double métaphore, à la fois de la
recherche du vrai (la dialectique pour Platon) et de l’opinion. Les prisonniers
n'ont pas besoin de chaînes : elles sont formées par leur foi dans ce qu’ils
voient. Leur pseudo savoir (celui des ombres) est précisément ce qui les tient
prisonniers. C'est d'ailleurs pour cela que seuls ils ne pourront entreprendre
de quitter la caverne. Il faudra doucement les forcer à regarder du côté de la
lumière et progressivement leur faire identifier dans les étapes successives de
leur progression, l'insatisfaction du résultat qu'ils obtiennent. On va, dans
cette progression critique, de l'illusion des sens (les ombres) aux vérités de
l'intelligible, (les essences, et au-delà, le souverain bien, symbolisé ici par
le soleil).
Le
texte revêt ici une sorte de valeur prophétique : connaître, progresser
vers le vrai, c’est toujours pour l’homme dénoncer d’abord une mauvaise
position du problème, reconnaître ce que l’on croit déjà savoir comme une
erreur. Prenons pour exemple ce que voient nos yeux et ce que sent notre corps : ils voient le
soleil qui tourne dans le ciel, il sent l’immobilité du sol sous nos pieds, et
l’ensemble de nos sensations nous donne l’opinion
que nous sommes fixes, centres d’un mouvement universel autour duquel
s’accomplit le mouvement des astres. Or, le génie de Copernic et Galilée est
d’avoir dénoncé la relativité de ce point de vue : ce mouvement n’est vrai
que relativement à l’observateur ; et Galilée démontrera la fausseté de
cette théorie, en transformant en simple point
de vue ce qui prétendait à la vérité.[4]
Qu’est-ce
que quitter l’opinion pour progresser vers le vrai ? C’est, par une
attitude critique portée sur nos représentations, rechercher à réaliser l’accord de la pensée et du
réel, ou de la pensée avec elle-même. Reconnaître que cet accord n’est jamais que partiel,
relatif et provisoire, c’est laisser la porte ouverte à une contestation
ultérieure de cette vérité, que nous regarderons alors comme une étape
nécessaire, mais provisoire, dans le progrès des connaissances. Cette
définition affirme le prima de la pensée rationnelle sur toutes les autres
formes d’accès au réel (sensibilité, imagination, croyance).
Et
cependant, nous pourrions montrer que la critique de l’opinion peut aussi
passer par une voie qui empruntera à la sensibilité et l’imagination : le paradoxe.
1.3 - Fonction du
paradoxe
Le paradoxe n’est pas, comme on le croit habituellement, une contradiction entre la pensée et le réel, ou une contradiction au sein de la pensée elle-même[5]. S’il fait référence à la racine grecque « doxa » (l’opinion), son préfixe « para » a une double étymologie : il indique à la fois l’idée de « se protéger contre (parer)» et d’être « à côté de ». Il en va du paradoxe comme il en va du parapluie ou du paratonnerre. Les uns nous protègent des éléments, l’autre nous protège de l’opinion. Mais le paradoxe est aussi à côté de l’opinion, comme la parapharmacie est aux côtés de la pharmacie, ou le technicien paramédical auprès du médecin.
Un paradoxe n’est pas une négation du réel ; il en est l’expression la moins fausse si l’on admet que notre représentation du réel relève toujours, d’une certaine manière de l’opinion (doxa). Il s’oppose donc à l’opinion, ce jugement sur le monde que nous croyons absolu, lors même qu’il témoigne de notre ignorance. Le paradoxe dénonce le mensonge de l’opinion en montrant qu’au-delà du monde rassurant des idées toutes faites, il est un monde plus inquiétant, mais aussi plus passionnant dans ce qu’il recèle d’inconnu et de surprise
 Ce
monde du paradoxe, qu’illustre la construction impossible ci-contre n’est pas
étranger à notre représentation du monde : il est lui-même une opinion, il emprunte ses éléments à notre vision
habituelle des choses, qu’il combine d’une autre manière
Ce
monde du paradoxe, qu’illustre la construction impossible ci-contre n’est pas
étranger à notre représentation du monde : il est lui-même une opinion, il emprunte ses éléments à notre vision
habituelle des choses, qu’il combine d’une autre manière
Simplement il dénonce une
imposture : celle de croire que notre regard habituel sur le monde exprime la
vérité du monde ; pour cela il lui oppose une autre imposture qui n’est
troublante que parce qu’elle pousse à l’absurde les lois qui régissent notre
représentation habituelle des choses
Ainsi, le paradoxe n’est pas une chimère, comme le rêve ou l’hallucination, son mensonge est une dénonciation, un rire salutaire.
A quelles conditions le paradoxe peut-il jouer son rôle d’ironie[6] ? Il doit pour cela répondre à trois exigences, dont la littérature ou les arts nous offriront des exemples :
- Le paradoxe est présent, à côté de notre représentation usuelle du monde et ouvre ainsi une « dialectique des possibles » une confrontation entre des points de vue différents. Il importe donc que, dans le paradoxe, le monde habituel soit présent, non pas tant parce que le paradoxe lui emprunte des éléments (des formes, des couleurs, etc), mais parce qu’il lui sert de référent. Le monde paradoxal ressemble beaucoup au nôtre, il doit se présenter avec la même consistance et la même familiarité que le monde ordinaire[7] dont il va montrer les failles.

Ainsi,
dans l’image[8] ci-dessus,
les éléments familiers (papier à cigarette, livre, fiole d’alcool, cactus, carnet
à croquis), semblent cohabiter sans hiatus avec les éléments purement
fantastiques
(la
sortie du petit dragon de son dessin)
- Par ailleurs, le paradoxe ne doit pas être résolutoire : ce qui signifie qu’il ne doit pas proposer, comme le fait la « chute » d’une histoire drôle, de sortie permettant au lecteur de réintégrer son monde rassurant et familier, le monde de l’opinion. On peut penser à la fin du film de Hitchcock Les oiseaux dont les héros s’enfuient sur la route, sans qu’on puisse dire quelle est la fin heureuse ou malheureuse du cauchemar.

Dans la vignette ci-dessus, il ne semble pas y avoir non plus de perspective résolutoire. En dépit de la porte ouverte en haut de l’escalier, les pénitents semblent définitivement condamnés à monter (à moins que ce ne soit à descendre) un escalier sans fin. Les deux autres personnages semblent là pour donner l’échelle de la résignation et du désespoir.
- Enfin, il ne faut pas que le lecteur/spectateur puisse se situer par rapport au récit ou à l’image. Est-il extérieur, celui qui lit ou regarde confortablement installé dans son monde ? Est-il l’acteur involontaire de l’action ? Son propre monde n’est-il qu’une province de l’univers décrit par l’auteur ? Dans la première de ses Fictions, Tlön, Borges se plaît à brouiller les pistes : est-ce une enquête menée par des rats de bibliothèques sur une secte spiritualiste du XVIIe siècle ? Est-ce une parodie de thèse universitaire, dont on reproduira à l’envie les prétentions érudites et snobes, ou notre propre monde n’est-il pas en voie de « tlönisation », ne serions nous pas en pleine mutation spiritualiste ?

Où sommes nous ?
Sommes-nous en train de
regarder une gravure de Escher ?
Sommes nous spectateurs dans
une galerie d’art où sont exposées des œuvres de Escher ?
Cette galerie est-elle dans
la ville ou la ville dans un tableau de la galerie ?
Etc…
Le paradoxe nous délivre de l’opinion. Il participe de cet « humour blanc », humour métaphysique dont parle Tournier dans Le vent Paraclet (p.198-9, Folio):
-
Mais il y a un comique
cosmique: celui qui accompagne l’émergence de l’absolu au milieu du tissu de
relativités où nous vivons. C’est le rire de Dieu. Car nous nous dissimulons le
néant qui nous entoure, mais il perce parfois la toile peinte de notre vie,
comme un récif la surface des eaux. A la peur animale des dangers de toute
sorte qui nous menacent, l’homme ajoute l’angoisse de l’absolu embusqué
partout, minant tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, frappant toute chose
existante de dérision. Tout est fait pour que le rire blanc n’éclate pas. La
grandiloquente abjection d’un Napoléon ou d’un Hitler — ce tumulte de
proclamations, de trompes, de canonnades et d’écroulements — n’ajoute ni ne
retranche rien à la tragique condition humaine, cette brève émergence entre
deux vides. Le rire blanc dénonce l’aspect transitoire, relatif, d’avance
condamné à disparaître de tout l’humain. (…)
L’homme qui rit blanc vient d’entrevoir l’abîme entre les mailles desserrées des choses. II sait tout à coup que rien n’a aucune importance. II est la proie de l’angoisse mais se sent délivré par cela même de toute peur. Nombreux sont ceux qui vivent et meurent sans avoir jamais éclaté de ce rire-là. Certes ils savent confusément que le néant est aux deux bouts de l’existence, mais ils sont convaincus que la vie bat son plein’, et que, pendant ces quelques années, la terre ne trahira pas leurs pieds. Ils se veulent dupes de la cohérence, de la fermeté, de la consistance dont la société pare le réel. ils sont souvent hommes de science, de religion ou de politique, domaines où le rire blanc n’a pas sa place. Ils sont en vérité presque tous les hommes. Lorsque les lattes disjointes de la passerelle où chemine l’humanité s’entrouvrent sur le vide sans fond, la plupart des hommes ne voient rien, mais certains autres voient le rien. Ceux-ci regardent sans trembler à leurs pieds et chantent gaiement que le roi est nu. Le rire blanc est leur cri de ralliement.
Ainsi, le paradoxe est pour nous un moyen d’accès au vrai, un moyen retors ou oblique, certes, puisqu’il consiste à ruser contre nous-même et contre les illusions de simplicité du monde dont nous berçaient nos habitudes de vivre ou de penser. Il nous révèle que le véritable obstacle à notre accès à la vérité n’est pas tant ce que nous ignorons encore, la complexité du réel, ou l’insuffisance de nos moyens : l’ennemi est intérieur, c’est cette paresse à penser qui nous fait toujours préférer le caractère rassurant de ce que nous croyons déjà connaître à l’abîme inquiétant de ce que nous ne connaissons pas encore.
2 – La vérité dans l’art : Apparence de l’art contre
le mirage du « réel »
Nous
postulions, plus haut, que l’accès à la vérité n’était pas le privilège de la
seule connaissance rationnelle, de celle qui se développe dans les sciences.
Nous voudrions à présent montrer dans la continuité l’analyse précédente sur le
paradoxe, que l’art nous offre une approche originale du vrai.
2.1
- Le “ready made” Marcel Duchamp[9]
et Man Ray
Ces
deux peintres vont ouvrir la voie vers une nouvelle approche de la vérité des
choses. A travers les « ready made »,
ces objets que l’on extrait de la vie quotidienne pour les regarder à la
manière des oeuvres d’art, dans des conditions spécifiques d’éclairage et de
présentation, nous révèlent ce que notre regard habituel sur les choses ne nous
permet plus de voir. Quand nous regardons une chaise, par exemple, nous n’y
voyons que l’utilité ou le confort, et secondairement le style s’il s’agit de
mobilier d’art. Mais prenons justement une chaise ordinaire, de fabrication
industrielle. Faisons-la tourner sous nos yeux, exactement comme nous pourrions
le faire d’une sculpture ou d’un objet d’orfèvrerie. Nous découvrons alors tout
un monde fait de rencontre de matières, de couleurs, de formes que nous avions
cessé de voir. Non pas que tout objet soit une œuvre d’art, mais parce que tout
objet peut être regardé comme nous
devrions regarder une œuvre d’art. Inversement, ceci peut nous apprendre à ne
plus regarder les œuvre d’art du même regard que nous portions sur les objets
ordinaires. « Ceci n’est pas une
pipe » avait inscrit au bas de son tableau Marcel Duchamp ; et de
fait la peinture semblait représenter
de manière très réaliste l’accessoire du fumeur. La mention de Duchamp nous
demande de regarder, pour une fois, l’œuvre pour elle-même et non pas à la
réduire à l’utilité ou à la signification que son objet référent a dans la vie
habituelle.
Ainsi,
la vérité de la chose (ce qu’est vraiment une chose, son en-soi) est inaccessible pour nous, puisque nous ne pouvons jamais
nous en faire qu’une représentation partielle et imparfaite. L’art nous apprend
à regarder : la construction de la vérité de la chose est une perspective
infiniment ouverte ; regarder le monde avec des yeux d’enfant, c’est le
penser comme un horizon infiniment ouvert à notre conquête du vrai.
2.2
- Hegel : apparence et illusion
L'art, dit-on, est le règne de l'apparence, de l'illusion, et ce que
nous appelons beau pourrait tout aussi bien être qualifié d'apparent et
d'illusoire.
[...] Rien de plus exact l'art crée des apparences et vit
d'apparences et, si l'on considère l'apparence comme quelque chose qui ne doit
pas être, on peut dire que l'art n'a qu'une existence illusoire, et ses
créations ne sont que de pures illusions.
Mais, au fond, qu'est-ce que l'apparence?
Quels sont ses rapports avec l'essence? N'oublions pas que toute essence, toute
vérité, pour ne pas rester abstraction pure, doit apparaître. Le divin doit
être un, avoir une existence qui diffère de ce que nous appelons apparence.
Mais l'apparence elle-même est loin d'être quelque chose d'inessentiel, elle
constitue, au contraire, un moment essentiel de l'essence. Le vrai existe pour
lui-même dans l'esprit, apparaît en lui-même et est là pour les autres. Il peut
donc y avoir plusieurs sortes d'apparence; la différence porte sur le contenu
de ce qui apparaît. Si donc l'art est une apparence, il a une apparence qui lui
est propre, mais non une apparence tout court.
Cette apparence, propre à l'art, peut, avons-nous dit, être considérée comme trompeuse, en comparaison du monde extérieur, tel que nous le voyons de notre point de vue utilitaire, ou en comparaison de notre monde sensible et interne. Nous n'appelons pas illusoires les objets du monde extérieur, ni ce qui réside dans notre monde interne, dans notre conscience. Rien ne nous empêche de dire que, comparée à cette réalité, l'apparence de l'art est illusoire; mais l'on peut dire avec autant de raison que ce que nous appelons réalité est une illusion plus forte, une apparence plus trompeuse que l'apparence de l'art. Nous appelons réalité et considérons comme telle, dans la vie empirique et dans celle de nos sensations, l'ensemble des objets extérieurs et les sensations qu'ils nous procurent. Et, cependant, tout cet ensemble d'objets et de sensations n'est pas un monde de vérité, mais un monde d'illusions. Nous savons que la réalité vraie existe au-delà de la sensation immédiate et des objets que nous percevons directement. C'est donc bien plutôt au monde extérieur qu'à l'apparence de l'art que s'applique le qualificatif d'illusoire.
HEGEL, Esthétique (1835),
trad. 1.-G. Aubier, Ed. Montaigne,
1944, pp. 26-27.
Le texte de Hegel est une critique de l’opinion commune selon laquelle l’art, puisqu’il n’est et ne vit que d’apparence, serait illusoire.
C’est par une interrogation sur le statut de l’apparence que Hegel répond à cette affirmation. Toute apparence est-elle illusoire ?
Il convient tout d’abord de se rappeler que l’homme n’a pas d’accès direct à la vérité. Toute vérité pour être pour nous doit apparaître. Seul un Dieu peut avoir un rapport direct à la vérité ou à l’essence, si bien qu’il n’y a, dans l’esprit de Dieu, aucune distance entre la représentation et la chose, ou l’idée représentée (Dieu dit lumière et la lumière fut) Mais nous ne sommes pas des Dieux. La vérité pour nous se manifeste, elle prend une apparence : celle d’un concept, d’une image, d’une forme. L’apparence est donc nécessaire. Pour exemple, nous pourrions appliquer ce principe à la connaissance d’un être. Qu’est-ce qui constitue la vérité d’un être, d’une personne. Bien malin qui peut répondre ! Même l’intéressé lui-même ! En fait, il va nous apparaître sous diverses apparences, divers avatars dont aucun n’est exhaustif à son être, mais qui exprime une vérité partielle de son être. Je ne suis réductible à aucune de mes manières d’être, ni le prof, ni le père de famille, ni à l’amateur de musique que je suis pourtant ; mais chacune de ces images de moi dit une (et non « la ») vérité de ce que je suis.
L’œuvre d’art se donne donc comme apparence, ou, mieux, comme un apparaître ; et même si on peut estimer que d’une certaine manière elle ne renvoie qu’à elle même, et non pas à une chose extérieure, elle prétend exprimer une vérité, une essence : le sublime, l’idéal, la beauté, la justice ou l’injustice, etc…
Or, par un singulier renversement dialectique, Hegel nous montre dans la suite du texte que le reproche d’illusion, que l’opinion faisait primitivement à l’art, se retourne contre l’opinion. En effet, à y regarder de plus près, il y a un mensonge dans la prétention qu’ont nos représentations usuelles et pratiques du monde extérieur, ou nos sentiments intérieurs, à valoir pour la réalité, alors qu’ils ne sont que des représentations de cette vérité. On prétendrait ainsi que cette table que nous percevons, que cette émotion que nous ressentons sont vraies. Qu’elles renvoient à quelque chose de réel, c’est ce dont on ne peut raisonnablement douter. Mais que la vision ou la représentation que nous en avons soit adéquate à ce réel, c’est ce qui ne résiste pas un seul instant à l’analyse. Car après tout, pour reprendre l’exemple de la table, il suffirait de changer d’échelle (par exemple au microscope électronique) pour voir cette « réalité » que nous pensions connaître clairement et distinctement se dissoudre en molécules et en atomes.
L’art au moins est plus honnête sur ce plan, puisqu’il ne prétend pas valoir pour la réalité. Si je regarde une nature morte, ou un portrait, il ne me viendrait pas à l’idée de manger les fruits du tableau, non plus que d’embrasser la Joconde ! Je sais bien que je regarde d’abord une peinture, c’est à dire un espace clos où jouent des rapports de forme, de couleur et de lumière.
2.3
- Bergson : l’élargissement de la perception
A quoi vise l'art, sinon à nous montrer, dans
la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne
frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience ? Le poète et le
romancier qui expriment un état d'âme ne le créent certes pas de toutes pièces
; ils ne seraient pas compris de nous si nous n'observions pas en nous, jusqu'à
un certain point, ce qu'ils nous disent d'autrui. Au fur et à mesure qu'ils
nous parlent, des nuances d'émotion et de pensée nous apparaissent qui
pouvaient être représentées en nous depuis longtemps, mais qui demeuraient
invisibles : telle, l'image photographique qui n'a pas encore été plongée dans
le bain où elle se révélera. Le poète est ce révélateur.
Bergson,
La pensée et le mouvant, La perception du changement p. 149-50
Dès
lors, nous devons considérer l’artiste comme le révélateur d’une vérité du
monde que nos manières habituelles d’agir et de penser nous cachaient.
L’artiste ne voit pas autre chose que tout un chacun pourrait voir ; seulement
il voit plus large, il a gardé son regard d’enfant et, intacte, sa capacité à
s’étonner.
|
Si
nous considérons telle sculpture de Rodin, celle, par exemple, que l’on nomme
(improprement si on en croit ce qui suit) le
baiser. Que nous révèle cet art ? ce à quoi nous ne sommes pas
attentifs, préoccupé que nous sommes de la vie pratique et signifiante. Il ne
nous montre pas un homme et une femme qui s’embrassent (la scène est
tellement banale et quotidienne que, mis à part des moutards effrontés qui
veulent s’instruire, elle n’intéresserait personne !) J’en veux
d’ailleurs pour preuve qu’il est assez difficile de dire si les lèvres des
personnages se joignent. La vérité est ailleurs, dans l’expression de la
tendresse humaine : dans la solidité, la force exprimée par le pied et
la jambe de l’homme, par le geste protecteur de la main de l’homme sur le
flanc de la femme, dans le mouvement du corps de la femme autour de celui de
l’homme qui culmine vers ce point invisible, précisément le baiser. Le soin
pris par Rodin d’exclure de la sculpture les éléments anecdotiques, pour
tendre vers une épure, témoigne de cette intention. Peu importe
l’inachèvement apparent de la sculpture des cheveux, peu importe même la
vérité anatomique du groupe sculpté, puisque c’est la composition d’ensemble
qui est expressive. |
|
Nous
pourrions en dire autant s’il s’agissait de rendre compte de l’essence, ou de
la vérité du mouvement. Si je regarde un athlète qui court, je suis plus
préoccupé par le record qu’il tente de battre, les adversaires qu’il tente de
vaincre etc… Mais préoccupé par ce caractère pratique et signifiant
socialement, je ne vois pas le mouvement, du moins ce qui est essentiel dans le
mouvement. Déjà le procédé du ralenti me permettrait d’apercevoir une allure,
la tension des muscles, la souffrance de l’effort. Mais une sculpture réalisera
ce prodige d’exprimer dans un bloc de marbre de plusieurs tonnes, et donc, par
définition, immobile l’essence du mouvement. La sculpture est un ralenti
extrême, non pas un simple « arrêt sur image », comme dans les
mauvais romans-photos où les personnages ont toujours l’air de « prendre
la pose », mais au sens où la vérité
du mouvement, ce qui
est essentiel dans le mouvement et dans l’effort humain va se trouver exprimé.
3 – La vérité dans les sciences : validité
rationnelle et vérité dogmatique
Il y a
quelques années, l’auteur de ces lignes a été le témoin de la discussion
suivante, entre un professeur de physique (phys) et un professeur d’histoire
(hist)
Hist :
Je pense qu’il y a en
Bretagne une qualité particulière de lumière
Phys :
Ce n’est pas très
rationnel ce que tu dis là : la lumière est la même partout
Quand la physicienne
dit « ce n’est pas très rationnel » elle veut faire comprendre à l’historienne
qu’elle s’est égarée dans un propos sans fond, bref qu’elle a dit une bêtise
(pardonnable d’ailleurs eût égard à sa condition de littéraire !) Elle,
sûre de son savoir, peut nous dire ce qu’est vraiment la lumière : et de
nous parler de photons, de longueur d’onde, de spectre visible, de fréquence…
en réaffirmant haut et fort comme un dogme irrécusable que le phénomène
lumineux est le même quelque soit la latitude !
Innocemment, nous
pourrions toujours lui faire remarquer que les artistes qui ont peint à
Pont-Aven ou à la Pointe du Raz n’avaient pas choisi ces lieux par hasard… Nous
eussions pu lui faire remarquer ironiquement qu’un tableau de Gauguin ou de
Sérusier en disait au moins autant qu’un traité de physique sur la
lumière ; nous aurions méchamment pu la ramener à ses éprouvettes et à ses
équations en lui demandant de définir ce concept d’énergie dont elle a plein la
bouche…
Tout
ceci pour amener une interrogation impertinente sur la nature de la vérité dans
les sciences et sur les limites dans lesquelles elles s’inscrivent.
Ne
doit-on pas parler à propos des science de « validité rationnelle »
plutôt que de vérité dogmatique ?
3.1 - Ethique du savoir [10]
Quelles
sont donc les exigences de la connaissance rationnelle ? Permettent-elles
de dégager une conception de ce qu’est la vérité dans les sciences ?

Connaissance
Rationnelle
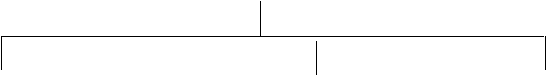



Cohérence Objectivité Falsifiabilité



Interne Externe
(adéquation)




Non Nécessité
& Suffisance
Contradiction
La cohérence d’un système rationnel se décline en cohérence interne (du système avec lui- même) et cohérence externe (du système par rapport à son objet)
La non contradiction exige qu’on ne trouve pas dans un système donné une proposition et son contraire. Si on prend un système comme la géométrie Euclidienne, sur la base de postulats, axiomes et définitions, on doit pouvoir bâtir un système non contradictoire de théorèmes ; l’objection de lui opposer des contradictions par rapport à d’autres systèmes, la géométrie de Riemann par exemple, au seul prétexte qu’elles seraient contradictoires, ne tient pas : seule une contradiction interne au système ruine sa prétention à la rationalité.
Par nécessité nous entendons que l’hypothèse ou la proposition formulée ne peut pas ne pas être. Ce qui exclut bien évidemment les hypothèses arbitraires ou purement conventionnelles. La nécessité va de pair avec la suffisance qui exprime l’état de complétude d’un système de représentations rationnelles. Cela porte d’une part sur l’extension d’une loi rationnelle qui doit être capable d’englober tous les cas de même espèce, sans exclusion ; cela signifie aussi que l’hypothèse utilisée se suffit à elle-même et ne nécessitera pas pour être validée d’apports extérieurs non validés.
La cohérence externe exprime l’adéquation d’une théorie quelconque à ses objets ou à son domaine d’application. Dans les sciences de la nature par exemple, c’est à l’expérimentation que reviendra la tâche de vérifier que la loi rend bien compte du phénomène visé. Il va sans dire qu’en cas d’infirmation l’hypothèse formulée devra être abandonnée. Remarquons que parmi toutes les sciences, les mathématiques n’ont pas cette exigence de retour au réel : les êtres dont parle le mathématicien sont des êtres purement abstraits, non des entités du monde sensible.
L’objectivité est une exigence éthique, déontologique pourrait-on dire de la connaissance scientifique. Elle est la volonté farouche de ne jamais mêler le sujet de la connaissance et l’objet de la connaissance en évitant en particulier que le premier projette des intentions subjectives sur le second. Dans l’histoire des sciences les exemples sont nombreux d’une rupture d’avec cette exigence, quand, par exemple, certains scientifiques prétendent avoir raison contre les faits. L’exigence d’objectivité prend un sens particulier dans le cas des sciences humaines à cause de la « proximité » existant entre l’objet de la connaissance et le sujet : l’historien qui étudie les époques passées est aussi l’homme d’une civilisation donnée, tout comme l’ethnologue. Ils doivent donc se prémunir contre le danger de lire une culture à la lumière des concepts et des valeurs de leur propre monde.
La falsifiabilité[11] : aucune connaissance rationnelle ne peut prétendre s’imposer comme un dogme éternel. Au contraire, toute loi scientifique doit être considérée comme valide une fois vérifiées les exigences précédentes de cohérence et d’objectivité. Mais la possibilité d’une critique ultérieure doit être maintenue : en droit, toute loi rationnelle peut être démentie par le cours ultérieur du développement de la connaissance.
Une théorie n’est donc qu’une représentation d’une réalité, mais ne vaut pas pour cette réalité. Cette représentation, pour être rationnelle, doit pouvoir satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus. C’est à ce titre et seulement à ce titre qu’elle peut être considérée comme valide, au bénéfice d’inventaire, c’est à dire tant qu’une représentation plus précise de cette réalité psychique ne viendra pas s’y substituer.
On ne
devrait donc pas parler de vérité dans les sciences, mais de validité du
discours entendant par là l’accord obtenu entre la pensée et le réel, ou dans
le cas des mathématiques, l’accord entre la pensée et elle même.
3.2
- Hasard et nécessité ou Providence divine ?
Mais
quelles sont les limites de validité du discours des sciences. Nous voudrions
montrer, dans l’opposition des théories de deux penseurs, P. Teilhard de Chardin
et J. Monod[12]. L’intérêt
de cette confrontation repose sur le fait qu’ils ont tous deux travaillé en
scientifiques sur un problème commun, (la question de l’évolution) et qu’ils en
ont tous deux tiré des conclusion ou en tous cas tenté, à partir de leurs connaissances,
d’apporter une réponse à une question ontologique fondamentale : le
pourquoi de la vie.
3.2.1 Le problème commun
La
confrontation entre les deux penseurs se fera autour d'un problème qui fait à
la fois l'objet d'une réponse scientifique, de la part des biologistes et des
paléontologues et d'une réponse de la part du croyant ou du théologien. En fait
la question posée, celle de l'apparition de la vie et de l'homme sur terre, est
à l'exacte limite entre connaissance et croyance.
Cette question
est importante, et concerne également le philosophe : elle est à l’exacte
intersection du non-vivant et du vivant, du non pensant et du pensant. Si la
philosophie se pose les questions ontologiques du « pourquoi la vie »
et du « pourquoi la pensée » (ou plus largement, « pourquoi
quelque chose plutôt que rien ? » elle ne peut faire l’économie d’une
réflexions sur ces deux orientations de la pensée humaine.
Quelles
sont les données générales du problème ?
Les
organismes vivants se distinguent des structures inanimées par deux
propriétés :
L’émergence, d’une part, qui est la capacité
des organismes vivants de se reproduire, ou plus exactement de reproduire leur
structure.
La
téléonomie, d’autre
part qui est la capacité de la vie d’évoluer vers des formes de plus en plus
complexe, depuis le unicellulaires jusqu’à l’homme.
Ce qui
va opposer nos deux penseurs, c’est de savoir si la téléonomie précède et guide
l’émergence (Teilhard), ou si au contraire la téléonomie n’est que le résultat
de l’émergence (Monod). En d’autres termes : y a-t-il une intelligence et
une bonté (en un mot une Providence) créatrices qui guide le processus évolutif
et le fait aboutir à l’homme, ou, au contraire, ce processus est-il entièrement
réductible à la double intervention de
nécessités physico-chimiques et du hasard ?
3.2.2 La thèse de Teilhard
Notons
tout d’abord que, même si Teilhard de Chardin est prêtre, sa théorie se veut
tout d’abord une hypothèse rationnelle, et c’est sur le plan de la connaissance
qu’il situe son interprétation. Teilhard est également paléontologue, ce qui
l’a amené en particulier à découvrir « l’homme de java », un
pithécanthrope (1938).
Teilhard
propose une lecture optimiste de la théorie de l’évolution de Charles Darwin15,
hypothèse selon laquelle le vivant tout entier devrait être pensé comme une
généalogie : depuis les origines de la vie, et jusqu’aux espèces vivantes
peuplant aujourd’hui la biosphère, la vie se serait développée selon un axe de complexification
croissante présent
dans toutes les sous-branches de l’arborescence de l’histoire de la vie. Ainsi,
si l’homme ne descend pas du singe, sans doute ont-ils tous deux un ancêtre
commun, un même phylum qui,
lui, a disparu en tant qu’espèce.
Le
concept de complexification est à comprendre en plusieurs sens : d’une
part, il s’agit d’une complexification dans les structures atomiques et
moléculaires, puis une complexification dans l’organisation (structuration)
interne des systèmes vivants, puis une complexification, après l’apparition du
système nerveux chez les animaux, de la structuration de ce système. Au-delà,
chez l’homme la complexification se fait de manière interne, dans l’apparition
progressive des structures de conscience, liées à l’apparition de la faculté de
parler et à la complexification des structures de vie sociale.
Une
telle lecture n’est-elle pas anthropocentrique ? Pour quelle raison doter
l’homme de la dignité de bourgeon terminale du Phylum général de la vie ?
Après tout chaque terminaison d’une branche de l’évolution ne pourrait-elle
pour son propre compte revendiquer ce statut ? Non, nous dit Teilhard,
cette lecture est simplement qualitative. Elle se contente de constater
Que les
formes végétales par exemple vont le plus loin qu’elles peuvent dans la
complexification des structures simplement vivantes. Mais que seul le règne
animal développe le système nerveux, c’est à dire qu’il s’engage dans un
processus de complexification
totalement original, dans une voie que le végétal ne pourra exploiter. La même
remarque vaudrait pour le passage de la pensée animale à la pensée
humaine : aucun animal ne parle ni ne pense et les hominidés ont été les
seuls à développer ce mode original de complexité que présente la pensée
consciente ?
Tout
ceci indique une orientation pour Teilhard, une finalité dont nous ne sommes
qu’un des termes provisoires. Ainsi la
genèse, la création du monde, de la vie et de l’homme s’ordonne dans une
cosmogénèse (création de l’univers physique),
se poursuit dans une biogénèse (création de la biosphère, la sphère de
la vie), et culmine dans une noogénèse (apparition et développement de l’esprit
dans une noosphère, ou sphère de l’esprit).
Notons
que Teilhard raisonne en anthropologue, non en biologiste. C’est sans doute,
indépendamment de la question métaphysique un motif d’opposition à J. Monod. Il
ne raisonne en effet pas en termes de support physiologique de l’évolution,
mais sur le plan de la lecture de l’arborescence de la vie.
|
|
Pourquoi chercher à voir? et
pourquoi tourner plus spécialement nos regards vers l’objet humain? Voir. On pourrait dire que
toute la Vie est là, — sinon finalement, du moins essentiellement. Etre plus,
c’est s’unir davantage: tels seront le résumé et la conclusion même de cet
ouvrage. Mais, le constaterons-nous encore, l’unité ne grandit que supportée
par un accroissement de conscience, c’est-à-dire de vision. Voilà pourquoi,
sans doute, l’histoire du Monde vivant se ramène à l’élaboration d’yeux
toujours plus parfaits au sein d’un Cosmos où il est possible de discerner
toujours davantage. La perfection d’un animal, la suprématie de l’être
pensant, ne se mesurent-elles pas à la pénétration et au pouvoir synthétique
de leur regard? Chercher à voir plus et mieux n’est donc pas une fantaisie,
une curiosité, un luxe. Voir ou périr. Telle est la situation, imposée par le
don mystérieux de l’existence, à tout ce qui est élément de l’Univers. Et
telle est par suite, à un degré supérieur, la condition humaine.(…) En vérité, je doute qu’il y ait pour l’être pensant de minute plus
décisive que celle où, les écailles tombant de ses yeux, il découvre qu’il
n’est pas un élément perdu dans les solitudes cosmiques, mais que c’est une
volonté de vivre universelle qui converge et s’hominise en lui. L’Homme, non pas centre
statique du Monde, — comme il s’est cru longtemps; mais axe et flèche de
1’Evolution, — ce qui est bien plus beau.[13] |
On le
voit, le point de vue de Teilhard est que la téléonomie précède et guide
l’émergence : s’il ne va pas jusqu’à tirer des conclusions métaphysiques
de sa thèse, il n’empêche que penser l’évolution comme finalisée, comme menant
vers un terme, c’est répondre à l’avance à la question d’une intelligence ou
d’un Dieu pour la concevoir.
3.2.3 La thèse de Monod
Monod
va synthétiser ses réflexions sur la vie dans un ouvrage, paru en 1970 « Le
hasard et la nécessité » Ce titre est déjà une prise de position sur
le problème qui nous occupe, car il reprend une citation du philosophe
matérialiste grec Démocrite[14].
Le
point de départ de J. Monod, c’est que la caractéristique essentielle du vivant
n’est pas sa propension à évoluer, mais au contraire l’extrême fidélité des
mécanismes de reproduction. Si bien que, selon lui, c’est bien plutôt la conservation
et non la mutation qui est remarquable dans l’histoire du vivant. L’évolution
n’est donc pour lui qu’un cas particulier, statistiquement rarissime.
A
partir de cette observation initiale, on peut synthétiser le point de vue de
Monod, selon le schéma suivant :
NIVEAU
MICROSCOPIQUE (cellule)

1er
hasard :
Rencontre des
2 séries
d’événements
1ère nécessité :
reproduction
sans variation
2nd hasard :
2nd
nécessité :
Rencontre
du Sélection naturelle
microscopique
et
du
macroscopique
NIVEAU MACROSCOPIQUE (biosphère)
1ère
nécessité : reproduction
sans variation du code génétique
Cette nécessité a un support physico-chimique clairement identifié
depuis une quarantaine d’années : l’ADN (acide désoxyribo-nucléïque) dont
la molécule est porteuse des informations nécessaires à la reproduction de
l’être vivant. Monod insiste sur le fait que c’est la seule nécessité
identifiable au niveau de la cellule : un organisme vivant n’est fait que
pour se reproduire identique à lui-même. Le fait le plus remarquable de la vie,
c’est la efficacité de cette transmission : en attestent des espèces
vivantes qui nous sont parvenues identiques à ce qu’elles étaient à l’ère
primaire.
Cette nécessité s’oppose donc à l’évolution : si elle
était absolument fiable, la vie n’aurait jamais du évoluer, et nous aurions une
terre peuplée d’une seule espèce de bactéries.
1er
hasard[15] :
Rencontre de deux
séries d’évènements
Or, nous constatons que les espèces vivantes connaissent
des mutations. Quelle est leur origine ? Selon Monod, aucune structure
chimique de la cellule n’a en charge cette fonction de mutation. Si le code
génétique d’une espèce change, ce ne peut être qu’à la suite de l’altération de
ce code par un phénomène extérieur au code, un événement fortuit comme par
exemple une infection, ou une radiation. Il en résulte une lignée mutante, qui,
à la condition que sa mutation lui permette de survivre, va se reproduire
concurremment à la lignée mère.
Les deux séries d’évènements, la reproduction de l’ADN
d’une part, et le phénomène perturbateur de cette transmission d’autre part
sont donc indépendantes l’une de l’autre, leur rencontre ne peut être déduite
ni de l’une, ni de l’autre. C’est pour cette raison que Monod nomme hasard
cette rencontre.
Rien dans la cellule, relève Monod, ne permet de corriger
la modification accidentelle du code génétique. Une fois acquise, l’altération
va se transmettre.
La vie aurait donc dû dégénérer : la multiplication
infinie des espèces aurait conduit à un désordre incompatible avec l’idée même
de structure organisée.
2nd
nécessité :
Sélection naturelle
Or, nous constatons non une dégénérescence et une
multiplication infinie d’espèce, mais au contraire une évolution qui semble
aller vers une complexification croissante des structures. Il faudrait donc
admettre que quelque chose vient corriger ou trier les erreurs.
C’est ici qu’intervient une seconde nécessité, à partir
d’une hypothèse de la sélection naturelle, postulée au XIXe siècle par Charles
Darwin[16]
La sélection naturelle est essentiellement une théorie
statistique, qui pourrait se formuler ainsi : « dans un biotope
donné, la lignée la mieux adaptée a un maximum de descendance » ce qui
revient à dire qu’elle finit par s’imposer dans ce biotope.
C’est ce qui explique à la fois que nous ayons assisté à
une évolution positive, vers plus de complexité d’organisation des structures
vivantes, et d’autre part à une diversification des lignées, en fonction des
milieux. Car dans une telle hypothèse, une mutation n’est jamais positive ou
négative que relativement au milieu. Ce qui explique que dans la concurrence
entre lignées, en fonction du milieu, ce ne soit pas toujours la même qui l’ait emporté, une mutation favorable à une lignée
dans un milieu donné pouvant bien se révéler défavorable dans un autre
contexte.
C’est donc une loi macroscopique qui vient corriger des
erreurs commises au niveau microscopique
2nd
hasard : Rencontre
du microscopique et du macroscopique
Or, c’est pour cette raison que Monod introduit de nouveau
l’idée du hasard. En effet, les deux séries d’évènements, microscopique et
macroscopique n’ont rien à voir l’une avec l’autre ; le mécanisme
correcteur est totalement étranger à l’erreur qu’il corrige. Nous serions donc,
comme l’affirme Monod en présence d’un second événement « au
hasard ».
On
remarque que la présentation de la théorie de Monod insiste initialement sur la
dimension biologique du problème. Pour lui, l’émergence précède et produit la
téléonomie, mais non pas par une volonté, mais par la rencontre d’un jeu de
nécessités mécanistes et statistiques, et de hasards. Rien ne prédisposait
selon lui la vie à apparaître sur terre. « La
vie aurait aboutit par erreur à ce vivant capable d’erreur
[l’homme] », comme le dit G. Canguilhem. (cf. texte ci-dessous)
Nous
nous proposons à présent de montrer que les points de vue de nos deux auteurs
ne sont pas exempts de présupposés métaphysiques, et nous nous demanderons si
c’est en scientifiques ou en hommes de foi qu’ils ont tiré leurs conclusions.
3.3
- Le comment et le pourquoi, l’adhésion rationnelle et la croyance, la loi et
le dogme, la démonstration et la révélation
On l’a
vu, tout le débat porte sur le fait de nommer « hasard » ou
« Providence » la rencontre des diverses séries causales.
La
première chose que nous constatons, c’est que, dans les deux théories, celle de
Teilhard et celle de Monod, on peut facilement interchanger ces termes, sans
que cela ôte de la validité aux théories. Ainsi, la thèse de Monod décrit les
phénomènes de mutation et de correction de ces mutations d’une manière
satisfaisante, que l’on dise que les faits se déroulent « au hasard »
ou par « Providence ». C’est donc que l’emploi de l’un ou l’autre des
concepts est indifférent, et qu’ils ne sont pas condition de validité ni de l’une ni de l’autre
théorie.
C’est
un indice suffisant pour dire qu’ils sortent de la science. En fait, il eût été, sur le
plan strict de la théorie, indifférent dans les deux cas de postuler l’une ou
l’autre de ces hypothèses.
D’autre
part, nous devons bien constater que ces deux hypothèses, hasard ou Providence
sont à renvoyer dos à dos sur le plan de la vraisemblance : quoi ! un
Dieu aurait-il mis en œuvre tant de solutions complexes, aurait-il autant
tâtonné, ne serait-il pas allé, comme dans la genèse, droit au but en créant un
homme à son image, au lieu d’emprunter tant de moyens détournés, tant de voies
de garage pour parvenir à son but ? Quoi ! comment voulez-vous qu’une
accumulation aussi impressionnante de hasards ait abouti à cet être paradoxal
qu’est l’homme ? Comment croire que de tels processus aveugles aient pu
aboutir à cette merveille de la pensée humaine plutôt qu’à un néant ? Pour
dire vrai, chacune
des deux hypothèses semble aussi improbable, sur le plan de la raison, l’une
que l’autre.
Que
dire d’hypothèses qui sont d’une part indifférentes à la validité d’un système
et d’autre part qui se présentent à nous avec le même degré
d’improbabilité ? Sûrement qu’elles ne relèvent pas de la connaissance, mais de la
croyance. Elles sont
toutes deux des professions de foi, l’un en la Providence (bonté de Dieu),
l’autre en le hasard. Elles sont toutes les deux des choix volontaires et
libres d’hommes qui décident de donner l’un, un sens sacré à la création,
l’autre une absence de sens à un processus à la fois nécessaire et stochastique[17].
Qu’on
ne nous objecte pas que par sa thèse Monod ne croit en rien et qu’elle s’oppose
à celle de Teilhard, qui serait lui-même aveuglé par la foi. Monod, puisque
rien ne peut nous permettre de trancher entre hasard et providence, fait un
acte de foi, prononce son Credo, en décidant d’appeler cela le hasard. Mais en
faisant cela, il sort du champ de la science : c’est en tant qu’homme, non
en tant que savant, qu’il prend position. En cela sa foi est aussi respectable
et difficile à vivre que celle de Teilhard.
Certes
il y aurait toujours une tierce possibilité, mais qui ne semble pas être celle
adoptée par Monod, puisqu’il tranche entre les deux hypothèses. Cette tierce
position serait l’agnosticisme[18],
le fait de refuser de se poser une question à laquelle la raison ne peut
répondre. Mais n’est-ce pas une solution de facilité que de balayer d’un revers
de main toute interrogation métaphysique, en prétendant « que l’humanité
doit renoncer à se poser des questions qu’elle ne peut résoudre[19] » ?
Ces
vues peuvent nous permettre de délimiter assez clairement le domaine de vérité
des sciences :
-
![]() Les sciences ne peuvent répondre qu’à la question « comment », non à la question « pourquoi ». Dès que l’on passe le
seuil de la première pour entrer dans la seconde, on quitte le champ de la
connaissance scientifique pour celui de la croyance.
Les sciences ne peuvent répondre qu’à la question « comment », non à la question « pourquoi ». Dès que l’on passe le
seuil de la première pour entrer dans la seconde, on quitte le champ de la
connaissance scientifique pour celui de la croyance.
-
 La vérité dans les sciences consiste à adhérer
rationnellement, sur le mode d’une nécessité démonstrative à des conclusions dont on a
vérifié la validité. Il ne dépend plus de nous de refuser de donner notre
consentement à telle ou telle théorie, si elle satisfait aux exigences que nous
énumérions plus haut[20].
La croyance, elle, est libre de donner ou non son consentement à telle ou telle
vérité
révélée. Rien ne peut
certifier au croyant que demain il croira encore, et la tentation du doute fait
partie intégrante de la foi religieuse. Mais il ne dépend pas du sujet de créer
son propre dogme : hors exégèse, la foi est aussi un abandon à la
certitude de la vérité révélée, la certitude du dogme.[21]
La vérité dans les sciences consiste à adhérer
rationnellement, sur le mode d’une nécessité démonstrative à des conclusions dont on a
vérifié la validité. Il ne dépend plus de nous de refuser de donner notre
consentement à telle ou telle théorie, si elle satisfait aux exigences que nous
énumérions plus haut[20].
La croyance, elle, est libre de donner ou non son consentement à telle ou telle
vérité
révélée. Rien ne peut
certifier au croyant que demain il croira encore, et la tentation du doute fait
partie intégrante de la foi religieuse. Mais il ne dépend pas du sujet de créer
son propre dogme : hors exégèse, la foi est aussi un abandon à la
certitude de la vérité révélée, la certitude du dogme.[21]
-
![]() La loi en physique ou en biologie peut toujours être modifiée, voire contestée par une
génération suivante de scientifique. Le dogme religieux, lui, en tant qu’il est révélé par Dieu, ne souffre
aucune modification de la part du croyant. La loi rationnelle est donc par
essence falsifiable, le dogme est une vérité marquée du sceau de l’absolu et de
l’éternel.
La loi en physique ou en biologie peut toujours être modifiée, voire contestée par une
génération suivante de scientifique. Le dogme religieux, lui, en tant qu’il est révélé par Dieu, ne souffre
aucune modification de la part du croyant. La loi rationnelle est donc par
essence falsifiable, le dogme est une vérité marquée du sceau de l’absolu et de
l’éternel.
-
Enfin,
la loi scientifique est le résultat de la raison et de l’expérience humaines.
Le dogme religieux, lui provient d’une source surnaturelle, Dieu
On ne
devrait donc pas parler, dans les sciences, de vérité, réservant ce terme à
l’absolu de la certitude religieuse. Le terme qui convient aux sciences est
celui de justesse (au sens de la justesse d’un résultat ou d’une observation)
ou mieux, de validité.
Conclusion générale :
La
vérité, pour les êtres humains, n’est jamais que la « vérité en marche ».
Elle se caractérise comme un processus dynamique, un mouvement vers. Il
s’ensuit que l’homme est en perpétuelle recherche de cette vérité, toujours
désirée, jamais atteinte.
Comment expliquer l’histoire de la connaissance, qui est
l’histoire des erreurs et l’histoire des victoires sur l’erreur ? Faut-il
admettre que l’homme est devenu tel par mutation, par une erreur
héréditaire ? La vie aurait donc abouti par erreur à ce vivant capable
d’erreur. En fait, l’erreur humaine ne fait probablement qu’un avec l’errance.
L’homme se trompe parce qu’il ne sait où se mettre. L’homme se trompe quand il
ne se place pas à l’endroit adéquat pour recueillir une certaine information
qu’il recherche. Mais aussi, c’est à force de se déplacer qu’il recueille de
l’information, ou en déplaçant, par toutes sortes de technique, (…) les objets
les uns par rapport aux autres, et l’ensemble par rapport à lui. La
connaissance est donc une recherche inquiète de la plus grande quantité et de
la plus grande variété d’information. Par conséquent, être sujet de la
connaissance,(…) c’est seulement être insatisfait du sens trouvé. La
subjectivité, c’est alors uniquement l’insatisfaction. Mais c’est peut-être là
la vie elle-même. La biologie contemporaine, lue d’une certaine manière, est,
en quelque façon, une philosophie de la vie.
G. Canguilhem[22]
Michel Le Guen (25/02/2001)


