On remarque donc, dans la culture
occidentale, une véritable rupture dans l’intérêt porté à l’histoire. Cette
rupture est contemporaine de la « crise » introduite par la
révolution copernicienne. Pourquoi cette apparition de la conscience
historique ? En quoi est-elle liée à la naissance de la modernité ?
Quelques signes tout d’abord de
ce changement. D’une part l’une des dispositions de l’Edit de Villers-Cotterêts
en 1539 établit en France l’ancêtre de l’état civil, les registres de baptême,
mariage et sépulture. A compter de cette date, toute personne née, ou mariée,
ou décédée en France sera répertoriée. Une trace de l’existence des personnes
passe à la postérité. Autre manifestation tangible de cette conscience historique,
la naissance des archives de France, et l’intérêt nouveau porté aux antiquités.
Jusque là, on ne s’intéressait aux vestiges antiques que pour les piller :
le moyen-âge, période de bâtisseurs, fut aussi celle des démolisseurs. Ce n’est
pas principalement le temps, ou les tremblements de terre qui ont ruiné les
édifices romains, mais d’une part la volonté de christianiser les temples ou
encore de se servir des monuments comme de carrières. Dès la Renaissance,
l’intérêt porté aux antiques change, et prépare l’avènement des fouilles
pratiquées scientifiquement, comme à Pompéi par exemple.
Surtout, la science historique et
la réflexion philosophique sur le sens de l’histoire vont se développer,
progressivement au XVII et XVIIIe siècle, pour prendre une ampleur inégalée
dans l’histoire de la pensée au XIXe.
C’est enfin la naissance d’une
idéologie du progrès,
qui pense globalement que demain sera meilleur qu’aujourd’hui et que l’humanité
est lancée sur la voie d’un progrès indéfini. Les philosophes des lumières,
opposés en cela à Rousseau, furent au XVIIIème siècle les initiateurs de cette
idéologie.
Quelle est la cause d’une telle
mutation ? Nous croyons y déceler
une conséquence de la révolution copernicienne.
L’univers d’Aristote et de
Ptolémée, qui va servir de représentation à l’humanité occidentale pendant deux
millénaires est un monde clos, hiérarchisé et ordonné. L’homme y trouve sa
place par rapport à un ordre universel.
La totalité de référence, l’idéologie si l’on peut dire, est l’espace. Or, Copernic,
Tycho Brahe, Giordano Bruno, et Galilée vont ruiner ce cosmos antique. Le monde
après eux n’a plus de limites, de centre ni de hiérarchie. Finie la belle
représentation d’un monde supra lunaire porteur de toutes les perfections et
d’un monde sublunaire lieu de la génération et de la corruption ; finie
l’illusion d’un univers clos où le ciel nous était promis et l’enfer, sous nos
pieds, redouté. L’humanité occidentale voit le fondement de ses certitudes
ontologiques ruiné sous ses pieds :
It’s all in pieces, all coherence gone
John Donne
Une anatomie du monde
1611
A ce cri répond celui de Pascal
qui découvre par la science moderne, la « solitude glacée des espaces
infinis »
Exit la belle ordonnance du monde
grec, exit le cosmos, bonjour le nouvel ordre de la modernité, bonjour chronos.
C’est qu’en effet, faute de trouver dans l’espace une totalité fondatrice,
l’homme de la modernité va la chercher dans le temps. Son nouveau cosmos, c’est
l’histoire. Or, elle se présente aussi
initialement à lui comme un chaos :
It’s a tale, told by an idiot, full of noise
and fury
Signifying
nothing
William Shakespeare, Mac
Beth, acte III
La mythologie grecque avait
assigné à Zeus la tâche de mettre de l’ordre dans le chaos des titans.
L’humanisme moderne va donner à l’homme lui-même, maître de son devenir, la
mission d’établir l’ordre du « nouveau monde »
l’ordre de l’histoire.
Deux
productions de l’esprit attestent de cette mission :
-
La réflexion philosophique sur l’Histoire qui prend son
essor entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe. Les divers philosophes,
de Condorcet à Marx vont tous rechercher dans l’histoire :
o
Quelle est la fin de l’histoire ?
o
Quels en sont les acteurs ?
o
Quel en est le moteur ?
o
Quel est son modus operandi
Tous partageront
le même credo : que l’histoire a un centre, le présent du philosophe,
autour duquel s’ordonne un passé d’où l’on vient, et un avenir vers lequel on
tend comme vers notre réalisation ; tous auront la même foi dans le
progrès, qu’il soit celui de l’esprit humain (Condorcet), de la raison (Kant),
de l’Idée (Hegel), d’une société faite par l’homme pour les hommes
(Marx) ; tous enfin placent leur espérance dans une réalisation suprême de
l’homme.
-
La connaissance historique rationnelle, qui va rechercher
dans l’histoire des hommes un déterminisme analogue à celui que les physiciens
ont découvert dans l’ordre de la nature.
Ces deux
directions empruntées par la pensée de
l’histoire orienteront notre
réflexion :
L’Histoire a-t-elle un sens ?
L’histoire est-elle une science ?
Première partie :
philosophie de l’Histoire
L’histoire
a-t-elle un sens ?
Introduction :
Rousseau, « anti-philosophe de l’Histoire »
L’appellation
« anti-philosophe de l’Histoire peut surprendre ». Si tel est le cas,
pourquoi en parler ici ? Tout simplement parce que Rousseau est le seul
parmi les philosophes du XVIIIe siècle à ne pas avoir pensé l’Histoire comme un
progrès continu de la nature humaine. Il est aussi le seul à ne pas croire que
le bonheur des peuples arrivera nécessairement, comme conséquence d’un
déterminisme historique ; il est enfin le seul à dire que le bonheur des
peuples ne dépend pas des progrès du savoir, mais nécessitera le vouloir
des hommes.
Et cependant on ne peut nier que
Rousseau ait une perspective historique, on ne peut nier qu’il se soit
intéressé à la vie politique de son temps et qu’il ait voulu y jouer un
rôle ; on peut même dire que, refusant les hypothèses naturalistes, il a
démontré que l’inégalité sociale est un produit de l’Histoire.
L’intérêt de présenter ici son
point de vue, qui, à bien des égards s’oppose à celui des autres philosophes,
tient à ce que l’Histoire semble lui avoir donné raison contre tous les autres,
ce que nous nous proposons d’exposer.
L’état de nature, la
« mesure pour rien de l’Histoire »
Le paradoxe de parler de Rousseau
comme philosophe de l’Histoire, c’est qu’il adopte, dans la présentation de
l’état de nature, une position théorique, et donc an-historique.
L’état de nature est en effet
défini par lui comme :
Un état qui n’existe plus,
qui n’a peut-être point
existé,
qui probablement n’existera
jamais,
et dont il est cependant
nécessaire d’avoir des notions justes,
pour bien juger de notre
état présent.
Par une volonté clairement
exprimée, Rousseau refuse l’enquête historique sur l’origine de l’inégalité. Il
veut reconstruire théoriquement ce qu’est l’homme avant l’histoire : en
toute logique aucun homme, serait-il le plus sauvage, a une histoire ; il
ne peut donc nous servir à la description de l’état de nature. Comment décrire
un tel état ? En le construisant théoriquement comme le négatif de l’homme
civil :
Concluons qu’errant dans les forêts, sans industrie, sans parole, sans
domicile sans guerre et sans liaison,
sans nul besoin de ses semblables comme sans nul désir de leur nuire, peut-être
même sans jamais en reconnaître aucun individuellement, l’homme sauvage, sujet
à peu de passions, et se suffisant à lui-même, n’avait que les sentiments et
les lumières propres à cet état; qu’il ne sentait que ses vrais besoins, ne
regardait que ce qu’il croyait avoir intérêt de voir, et que son intelligence
ne faisait pas plus de progrès que sa vanité. Si par hasard il faisait quelque
découverte, il pouvait d’autant moins la communiquer qu’il ne reconnaissait pas
même ses enfants. L’art périssait avec l’inventeur. Il n’y avait ni éducation,
ni progrès; les générations se multipliaient inutilement; et, chacune partant
toujours du même point, les siècles s’écoulaient dans toute la grossièreté des
premiers âges ; l’espèce était déjà vieille, et l’homme était toujours enfant.
Une telle accumulation de négations a un sens : la description de
l’état de nature est obtenue par soustraction à l’état civil de tout ce qui
manifestement ne peut lui venir que de la société et de son histoire. L’homme a
l’état de nature est donc a-topique et a-chronique, a-social et ignorant, muet
et immobile à la place assignée par la nature. En bref, rien ne le distingue en
apparence de l’animalité. Certes, d’autres caractéristiques ne figurent pas
dans cette liste : la conservation, la pitié naturelle, la perfectibilité.
Mais ce sont aussi des qualités définies négativement, la première comme
l’instinct de survie, la seconde comme l’absence de désir de voir souffrir
inutilement tout être sensible ; quant à la perfectibilité, elle ne sera
mise en œuvre que dans l’état civil, elle n’est ici qu’en puissance, comme
faculté de devenir autre. C’est le seul point qui distingue l’état de nature de
l’animalité, encore n’est-ce, on le voit que de manière purement virtuelle.
Une autre constatation s’impose : on remarque que l’inégalité n’a
pas sa place dans cette description. Rousseau établit la distinction entre les
différences naturelles, de force, de taille, de sexe etc… et les inégalités
sociales, de richesse, de considération, de pouvoir, qui, manifestement, sont
des produits de l’histoire. Ce constat est d’une importance considérable :
si l’inégalité n’est pas naturelle chez l’homme, si elle est une conséquence de
l’existence sociale des hommes, alors on peut lutter contre elle ; si
l’homme était originellement pervers, aucune réforme de la société ne serait
possible ; si nous démontrons au contraire que c’est l’existence sociale
qui l’a perverti, au point qu’il peut asservir son semblable, alors on peut espérer
réformer la société, car ce que l’histoire a fait, l’histoire peut le défaire
ou le refaire.
Quel est le sens de cet état de nature ? Il s’agit de décrire
théoriquement ce qu’est un homme avant l’entrée dans l’histoire, afin de
démontrer que l’inégalité n’est pas de nature. Une analogie nous servira
d’explication, celle du jeu d’échecs : pour bien comprendre comment dans
une partie on en arrive à une situation inégalitaire entre les deux joueurs, il
faut connaître, non seulement la marche des pièces mais aussi l’état de
l’échiquier avant le premier coup ; c’est cet état que l’on peut comparer
à l’état de nature ; lui aussi ne fait pas partie du jeu, et il est
cependant important de le connaître pour comprendre la partie ; la
situation des deux joueurs est égale au début du jeu, mais leur statut de
joueurs, tout comme celui de l’homme à l’état de nature est purement
virtuel ; il est important de le reconnaître pour comprendre la
suite : les échecs ne sont pas un jeu à handicap, la donne est la même
pour les deux joueurs.
L’état de nature est la mesure pour rien de l’histoire, semblable à cette
mesure pour rien que bât le cher d’orchestre avant que ne commence la
musique : elle aussi définit a priori la musique, mais n’en fait pas
partie.
La naissance de la civilité,
sociabilité et amour de soi
Le passage de l’état de nature à
l’état civil est décrit de deux façons :
-
La première, théorique résume l’essentiel de ce qu’est
un homme :
Le premier qui, ayant enclos
un terrain s’avisa de dire :
Ceci est à moi,
Et trouva des gens assez
simples pour le croire,
Fut le vrai fondateur de la
société civile.
On remarquera
que cette citation, qui inaugure la seconde partie du discours, s’oppose point par
point à la définition précédente de l’homme à l’état de nature. Qu’est-ce qu’un
homme civil (on serait presque tenté de demander «qu’est-ce qu’un homme,
tout court ») ? C’est un être qui parle (s’avisa de dire)
qui affirme son moi (ceci est à moi) qui revendique son intérêt propre (enclos
un terrain) qui fixe des conventions avec ses semblables (trouva des
gens assez simples pour le croire) bref c’est l’homme de la société (vrai
fondateur de la société civile). Remarquons que l’entrée dans la société est
contemporaine de la découverte du moi et de l’intérêt propre, donc à terme de
l’inégalité sociale : les fruits cessent d’être à tous, et
la terre à personne
-
La seconde, historique fait une concession à la
vraisemblance : Rousseau y décrit par quels méandres successifs et en
dépassant quels obstacles naturels les hommes en sont venus à préférer
l’existence sociale à leur insouciance native.
Quoiqu’il en soit de ces
commencements, Rousseau remarque que :
-
l’entrée dans la société est contemporaine de l’apparition
du moi : nous avons besoin des autres et de leur considération pour être
nous-mêmes.
-
Du même coup, nous découvrons que nous avons un intérêt
propre à défendre.
Sitôt que les hommes eurent
commencé à s’apprécier mutuellement, et que l’idée de la considération se fut
formée dans leur esprit, chacun prétendit y avoir droit, et il ne fut plus
possible d’en maquer impunément pour personne. De là sortirent les premiers
devoirs de la civilité, même parmi les sauvages ; et de là, tout tort
volontaire devient un outrage, parce qu’avec le mal qui résultait de l’injure
l’offensé y voyait le mépris de sa personne, souvent plus insupportable que le
mal même. C’est ainsi que, chacun punissant le mépris qu’on lui avait témoigné
d’une manière proportionnée au cas qu’il faisait de lui-même, les vengeances
devinrent terribles, et les hommes sanguinaires et cruels.
Il y a donc dès
l’origine de l’histoire une contradiction interne à la société, entre la
nécessité d’autrui pour moi (j’ai besoin de sa considération pour exister en
tant qu’être humain) et la découverte de mon intérêt propre. Découvrant dans
les relations sociales que je suis un sujet, je revendique du même coup la
satisfaction de mon intérêt, au détriment, ou au moins concurremment à
l’intérêt d’autrui. Cette contradiction entre amour d’autrui et amour propre,
Kant la nommera d’après Rousseau « l’insociable sociabilité »
Cette
contradiction nourrit le développement de la perfectibilité, la recherche de la
satisfaction des nouvelles passions nées de la vie sociale nous amenant à un
perpétuel dépassement de nous même. Il serait faux cependant de croire que ce
développement de la perfectibilité est un processus positif. Il est à la fois
positif et négatif, il est à la fois progrès vers la connaissance, le
bonheur des peuple et décadence passionnelle et asservissement de
l’homme par l’homme. En bref, la perfectibilité est la capacité de devenir
autre, c’est à dire meilleur ou pire.
On peut résumer l’analyse de Rousseau dans le tableau
suivant :
|
|
Etat de nature
|
Histoire
|
|
|
Un état qui n’existe plus, qui n’a jamais existé, et
qui probablement n’existera jamais
|
Bon sauvage
|
Etat civil
|
|
|

Stupidité des brutes :
sans :
|
- langage
- domicile
- propriété
- industrie
- sociabilité
- moi
- progrès
|
douceur originelle
« à
des distances égales de la stupidité des brutes et des lumières funeste de
l’homme civil »
|
Mise en oeuvre de la perfectibilité
Mouvement de dégradation de l’histoire : Lumières funestes
inégalités
violence
chute
progressive
vers
l’inégalité
et
l’aliénation absolue
|
|
|
Naturellement bon :
|
- Instinct
de
- conservation
- pitié
naturelle
- perfectibilité
|
|
« insociable
sociabilité »*
Contradiction entre le besoin d’autrui et l’amour de soi
*Kant
|
|
|
REFORME
de la société
|
|
Sensibilité
Retour à une morale du sentiment
pédagogie
L’Emile-1762
Morale naturelle
La Nouvelle Héloïse 1758
|
|
Raison :
Le
Contrat Social
1762
|
|
|
|
|
|
|
|
La pente naturelle de l’histoire
n’est donc pas nécessairement positive ; au contraire, à laisser jouer les
antagonismes au sein de la société on risque fort d’aller vers une situation de
plus en plus inégalitaire : la mise en œuvre de la perfectibilité peut
conduire à l’aliénation de l’homme par l’homme.
Faut-il pour autant désespérer de
l’histoire ? Loin de là ! En effet, comme cette situation
inégalitaire n’est pas un fait de nature, mais d’histoire, on peut espérer
réformer la société. Rousseau, comme il a pu le faire pour son existence
personnelle, propose
ici une réforme selon deux voies, l’une par la sensibilité, l’autre par la
raison :
La voie (ou
la voix ?) de la sensibilité est développée dans les œuvres
littéraires de Rousseau, comme en particulier l’Emile, où il nous expose
comment, en faisant appel aux seules dispositions naturelles de la sensibilité,
on peut préserver un être des perversions liées au commerce des hommes dans la
société. Il s’agit d’un retour, non à l’état de nature, comme on l’a dit
parfois, mais à un état proche de la vie sauvage (« le bon
sauvage »).
La voie (ou
la voix ?) de la raison : le contrat social. La raison peut à la
fois asservir l’homme ou le libérer, comme nous allons l’étudier à présent
Le contrat : la voie ou
la voix de la raison
Le contrat social est une
construction rationnelle qui fait appel à deux facultés héritées de la vie
sociale : la raison et à la volonté des individus. Comment arriver à vivre
en société sans que la liberté des uns ne ruine la liberté des autres ?
Comment concilier sûreté de sa personne et de ses biens avec la liberté ?
Comment s’assurer que la loi est la même pour tous ? Tels sont les
problèmes que prétend résoudre cette construction rationnelle qu’est le contrat
social :
« Trouver une forme
d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et
les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous,
n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi libre qu’auparavant »
Il s’agit de faire en sorte que
nous puissions reconnaître dans la loi sociale notre propre loi « l’obéissance
à la loi qu’on s’est prescrite est liberté » Cela n’est possible qu’au
prix d’un pacte fondamental, antérieur à toute loi particulière, et qui soit
l’émanation de la volonté générale, elle même expression unanime des volonté
particulières. Cette construction n’est possible qu’à trois conditions :
-
l’unanimité de l’abandon des libertés particulières au
profit d’une liberté sous les lois
-
Le caractère exhaustif de cet abandon
-
La réciprocité des engagements, des droits et des
devoirs
On peut bien sûr juger qu’une
telle association est utopique.
Cependant nous remarquerons que Rousseau échappe à cette critique :
-
Tout d’abord parce que le contrat social n’est pas
présenté par lui comme la conséquence nécessaire d’un déterminisme historique
indépendant de la volonté des hommes, mais au contraire comme une construction
qui ne se fait que par leur libre adhésion.
-
D’autre part, parce qu’en tant que construction
humaine, il est nécessairement voué à la mort
-
Enfin parce que, si l’insociable sociabilité est
inhérente à toute société, on ne voit pas pourquoi elle disparaîtrait d’une
société du contrat.
On ne peut donc poser le contrat
social comme une société parfaite, une utopie, mais comme société « du
mieux qu’elle puisse être ». Nul ne
peut éradiquer de la société la contradiction entre amour de l’autre et amour
de soi, puisqu’elle naît des conditions mêmes de l’existence sociale. Le
contrat, œuvre de la volonté raisonnable des hommes, ne peut se maintenir
qu’autant que cette volonté raisonnable continue à s’exercer ; mais il est
menacé par la rivalité des intérêts particuliers sans cesse renaissants. Il
constitue donc un palier d’égalité dans la pente inégalitaire de l’évolution des sociétés humaines, non un
terme définitif.
Pour Rousseau, il n’y a donc pas
de fatalité du malheur ni du bonheur des hommes : il leur revient
d’exercer leur volonté et leur raison pour réformer le monde.
Nous nous proposons de montrer,
dans les analyses qui suivent, que les autres philosophes de l’histoire qui lui
ont succédé n’ont pas toujours eu la même prudence que lui, avant de nous
demander si l’histoire ne lui a pas donné raison.
|

J. J. Rousseau
(1712-1778)
|
On pourrait ajouter à l’acquis de l’état civil la
liberté morale, qui seul rend l’homme vraiment maître de lui ; car
l’impulsion du seul appétit est esclavage, et l’obéissance à la loi qu’on
s’est prescrite est liberté.
Rousseau, Du contrat social Livre I, ch. X
On peut aussi accorder entre elles et avec la raison
des affirmations qui furent si souvent dénaturées et en apparence contradictoires
du célèbre
J. J.
Rousseau. Dans ses ouvrages sur « l’influence des sciences » et sur
« l’inégalité des hommes »
il montre très justement la contradiction inévitable entre la
civilisation et la nature du genre humain en tant qu’espèce physique où
chaque individu doit réaliser pleinement sa destination
Kant, Conjectures sur les débuts de
l’histoire humaine
Rousseau ne s’est pas borné à prévoir l’ethnologie,
il l’a fondée.
D’abord de façon pratique en écrivant le Discours
sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes qui pose le
problème des rapports entre la nature et la culture… et ensuite sur le plan
théorique en distinguant avec une clarté et une concision admirable l’objet
propre de l’ethnologue de celui du moraliste et de l’historien
Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale
|
1 – Condorcet, ou la foi des
lumières
|

Marie Jean Antoine Nicolas
de Caritat, marquis de Condorcet (1743-1794)
|
Jadis mathématicien
Marquis, académicien,
Sous d’Alembert,
panégyriste,
Sous Panckouke,
encyclopédiste,
Puis, sous Turgot,
économiste,
Puis sous Brienne,
royaliste
Puis, sous Brissot,
républiciste,
Puis du trésor public
gardien,
Puis citoyen-soldat…, puis
rien
Satire sur Condorcet, Le Babillard 28 juillet 1791
Tel artisan s’est montré
habile dans la connaissance des droits de l’homme,
quand tel faiseur de
livres, presque républicain en 1788,
défendait stupidement la
cause des rois en 1793.
Tel laboureur répandait la
lumière de la philosophie dans les campagnes,
quand l’académicien
Condorcet, jadis grand géomètre, dit-on, au jugement des littérateurs, et
grand littérateur, au dire des géomètres, depuis conspirateur timide, méprisé
de tous les partis, travaillait sans cesse à l’obscurcir par le perfide
fatras de ses rapsodies mercenaires…
Robespierre, discours à la Convention 18 floréal
an II (7 mai 1794)
|
Ces deux citations donnent un bon
éclairage sur la personnalité complexe
de Condorcet. Né aristocrate, associé à l’aventure des encyclopédistes,
mathématicien qui introduisit
l’application des mathématiques à l’étude des phénomènes sociaux
(statistiques et probabilités), admirateur de Turgot sous Louis XVI, l’un des
principaux acteurs de la révolution de 1789 qui finira pourtant par le tuer, et
philosophe de l’histoire, de la pédagogie, féministe convaincu voici les
principaux traits de sa vie.
Son œuvre majeure « l’Esquisse
d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain » est écrite à
la hâte (d’où l’appellation « esquisse ») par un homme traqué par la
révolution qu’il a appelée de ses vœux, à laquelle il participa activement, et
dans laquelle il voit encore la promesse d’un avenir radieux pour l’humanité.
Tout d’abord Condorcet, en
philosophe des lumières, fait du progrès des connaissances le vecteur principal
du progrès des peuples. Les 10 époques de son tableau retracent comment se sont
développées corrélativement les connaissances, les moyens de leur diffusion, et
le bonheur de plus en plus étendu des peuples.
De sa lecture récurrente de ces progrès,
il tire un optimisme historique qui lui fait penser que demain sera meilleur
qu’aujourd’hui.
Il faut dire qu’il ne manque pas
d’arguments. La corrélation qu’il établit entre progrès des connaissances et
progrès de la diffusion du savoir semble difficilement contestable. Le langage
permet d’abord aux hommes de s’arracher au seul besoin pour accéder
progressivement à des nourritures plus spirituelles ; l’inventions des
écritures, idéogrammes figuratifs tout d’abord puis signes alphabétiques vont
permettre de conserver et de transmettre le savoir ; l’autre progrès
décisif sera l’invention de l’imprimerie, qui libèrera la connaissance des
frontières et des despotes, et favorisera une universalisation du savoir, en
particulier de celui des sciences. Et au-delà du XVIIIe siècle, dans cette
dixième période que Condorcet pense déjà comme la plus heureuse de l’histoire
de l’humanité, le philosophe prophétise le passage à une langue universelle,
promesse d’une compréhension et d’une paix perpétuelle entre les hommes.
En bon mathématicien, Condorcet
se refuse à fixer un terme à ce
progrès. Le progrès est indéfini, au double sens où on ne peut nommer et
décrire son terme, sa fin idéale, et d’autre part au sens algébrique d’infinité :
comme une asymptote tend vers l’infini, le progrès des connaissances tout comme
le bonheur de l’humanité tendent vers une réalisation idéale sans jamais
l’atteindre.
 Il
ne faudrait cependant pas représenter cette progression du bonheur des peuples
comme une gradation continue, mais plutôt comme un développement en dents de
scie, étant entendu que le progrès des connaissances est lui une progression
linéaire, selon le schéma suivant :
Il
ne faudrait cependant pas représenter cette progression du bonheur des peuples
comme une gradation continue, mais plutôt comme un développement en dents de
scie, étant entendu que le progrès des connaissances est lui une progression
linéaire, selon le schéma suivant :
Chaque progrès des connaissances
entraîne un progrès du bonheur de la liberté, etc., des peuples. Mais en même
temps ces bénéfices sont généralement confisqués par des puissances, telles que
les églises , les
puissants, les riches etc. , ce qui entraîne une régression, bientôt
suivie d’un nouvel élan. Il y a donc une place pour la négativité dans la
représentation que Condorcet fait de l’histoire. Déjà Rousseau, par la
contradiction entre amour de soi et amour de l’autre représentait l’histoire
comme comportant en son sein une source
de désordre ; Condorcet poursuit là une tradition qui se perpétuera
ensuite chez Kant (insociable sociabilité), chez Hegel (conflit des idées) et
chez Marx (lutte des classes).
Que penser du bel espoir de
Condorcet ?
Sommes-nous au point où nous
n’ayons plus à craindre, ni de nouvelles erreurs, ni le retour des anciennes ;(…) Serait-il donc inutile de
savoir comment les peuples ont été trompés, corrompus, ou plongés dans la
misère ?
Tout nous dit que nous touchons à l’époque
d’une des grandes révolutions de l’espèce humaine. Qui peut mieux nous éclairer sur ce que nous devons en attendre ;
qui peut nous offrir un guide plus sûr pour nous conduire au milieu de ses
mouvements, que le tableau des révolutions qui l’ont précédée et préparée? L’état
actuel des lumières nous garantit qu’elle sera heureuse ; mais aussi
n’est-ce pas à condition que nous saurons nous servir de toutes nos
forces ? Et pour que le bonheur qu’elle promet soit moins chèrement
acheté, pour qu’elle s’étende avec plus de rapidité dans un plus grand espace,
pour qu’elle soit plus complète dans ses effets, n’avons-nous pas besoin
d’étudier dans l’histoire de l’esprit humain quels obstacles nous restent à
craindre, quels moyens nous avons de les surmonter?
Il semble reposer sur trois
illusions, présentes dans ce texte :
-
« Tout nous dit, [tout] nous garantit » :
La première c’est qu’il y a un déterminisme nécessaire du progrès des peuples.
Condorcet croit que le « monde meilleur » arrivera nécessairement.
Cette croyance est commune nous allons le voir, à tous les philosophes de
l’histoire.
-
« A condition que nous saurons » :
Mais l’illusion majeure est de croire qu’un tel progrès social sera
uniquement une question de savoir,
de connaissance. La problématique de la volonté, du vouloir est
singulièrement absente de son propos.
-
« n’avons-nous pas besoin d’étudier dans l’histoire de l’esprit
humain quels obstacles nous restent à craindre » Condorcet ne
se pose pas la question, que Hegel n’éludera pas, de la possibilité de
« leçons de l’histoire »
Le point de vue de Condorcet illustre
la foi que les philosophes des lumières ont mise dans la raison humaine. Il
n’ont pas aperçu ce qu’avait compris Rousseau, que les produits de la raison
peuvent aussi bien asservir les hommes que les rendre libres et heureux.
L’histoire les démentira sur ce point.
2 – Kant, ou le culte de la
raison
|

Emmanuel Kant
(1724-1804)
|
Le professeur ne doit pas
apprendre des pensées…
mais à penser.
Il ne doit pas porter
l’élève
mais le guider si l’on
veut qu’à l’avenir
il soit capable de marcher
de lui-même
Annonce de M. Emmanuel Kant
Sur le programme de ses leçons
Pour le semestre d’hiver 1765-66
« Ose te servir de
ton entendement. »
« Tu dois, donc tu peux. »
Emmanuel Kant
|
La part consacrée à l’Histoire, dans
l’œuvre de Kant, est relativement modeste par rapport à celle occupé par la
réflexion métaphysique, morale ou esthétique. Nous nous proposons de l’aborder
à partir d’un opuscule paru en 1784 : Idée d’une histoire universelle
du point de vue cosmopolitique.
Le point de vue de Kant sur l’Histoire est fortement
influencé par les succès remportés depuis 150 ans par les sciences de la
nature. L’influence de Newton en particulier est marquée et Kant voudrait
découvrir dans l’Histoire un déterminisme analogue à celui que les physiciens
ont découvert dans la nature.
Quel que soit le concept
qu’on se fait du point de vue métaphysique de la liberté du vouloir, ses
manifestations phénoménales, les actions humaines, n’en sont pas moins
déterminées, exactement comme tout événement naturel, selon les lois
universelles de la nature. (…) ce qui, dans les sujets individuels nous frappe
par sa forme embrouillée et irrégulière pourra néanmoins être connu dans
l’ensemble de l’espèce sous l’aspect d’un développement continu bien que lent,
de ses dispositions originelles.
L’Histoire humaine n’est donc pas
pour Kant un chaos indéterminé, mais un prolongement de l’Histoire naturelle.
Si celle-ci est déterminée, c’est-à-dire coordonnée par un ensemble de
relations de cause à effet, l’Histoire des hommes qui en est le prolongement
doit aussi suivre le même principe.
Les hommes, pris
individuellement, et même les peuples entiers ne songent guère qu’en
poursuivant leurs fins particulières en conformité avec leurs désirs
personnels, et souvent au préjudice d’autrui, ils conspirent à leur insu au
dessein de la nature.
Cependant, ce n’est pas au niveau
de leurs volontés ou de leurs désirs individuels que les hommes réalisent leur
histoire. Cette idée, qui se retrouvera chez Hegel
et surtout chez Marx,
signifie qu’aucun homme ne peut prétendre conduire l’Histoire en fonction de
ses fins particulières. Seule une conception naturaliste de l’histoire permet
d’y déceler une constante de développement, et d’en comprendre les fins.
[les hommes] ne suivent pas
simplement leurs instincts comme les animaux ; ils n’agissent cependant
pas non plus comme des citoyens raisonnables du monde, selon un plan déterminé
dans ses grandes lignes. Aussi une histoire ordonnée (…) ne semble pas possible
en ce qui les concerne. (…) [La Philosophie doit] rechercher du moins si l’on
ne peut pas découvrir dans ce cous absurde des choses humaines un dessein de la
nature.
Cette idée de dessein de la
nature est un présupposé métaphysique : elle implique que la nature est
providentielle, et que, tant au niveau du vivant qu’au niveau du pensant,
l’Histoire est le développement d’un projet.
(…) est-il raisonnable
d’admettre la finalité de l’organisation de la nature dans le détail, et
cependant l’absence de finalité dans l’ensemble ?
L’Histoire humaine est donc
finalisée. Nous allons voir que cette finalité se déroule en plusieurs étapes,
car, pour envisager que les hommes puissent développer leurs facultés
raisonnables, il faut que les conditions de ce développement soient réalisées,
en particulier en ce qui concerne l’Etat. Dans un état de sauvagerie, les
hommes ne peuvent guère espérer réaliser des buts moraux. Seule une société de
droit peut permettre le développement des capacités spirituelles et morales de
l’homme.
Quels sont les buts poursuivis
par la nature à travers l’Histoire humaine ? On distinguera entre deux
formes de finalité, l’une à court terme, qui est le moyen ou la condition de la
réalisation de la moralité (la création d’une société de droit, puis d’une société
des nations) l’autre à long terme qui est la fin réelle, la moralisation des
sociétés humaines (le règne des fins).
On peut envisager l’histoire
de l’espèce humaine en gros comme la réalisation d’un plan caché de la nature
pour produire une constitution politique parfaite sur le plan intérieur et, en
fonction de ce but à atteindre, également parfaite sur le plan extérieur ;
c’est le seul état de choses dans lequel la nature peut développer complètement
toutes les dispositions qu’elle a mises dans l’humanité
Quels moyens la nature a-t-elle
mis en l’homme pour réaliser ses buts. D’une part la raison, d’autre part, la
liberté du vouloir. En privant l’homme d’une dotation animale lui permettant de
subvenir par instinct à ses besoins, en l’obligeant donc à travailler, la
nature le contraint à développer ses facultés de comprendre et de juger.
L’homme est condamné à mettre en œuvre ces facultés, condamné à développer sa
perfectibilité.
La nature a voulu que
l’homme tire entièrement de lui-même tout ce qui dépasse l’agencement mécanique
de son existence animale, et qu’il ne participe à aucune autre félicité ou
perfection que celle qu’il s’est crée lui-même, indépendamment de l’instinct
par sa propre raison. En effet, la nature ne fait rien en vain, (…) en munissant
l’homme de la raison et de la liberté du vouloir qui se fonde sur cette raison,
elle indiquait déjà clairement son dessein en ce qui concerne la dotation de
l’homme. Il ne devrait pas être gouverné par son instinct (…) il devrait bien
plutôt tirer tout de lui-même.
Cependant, force nous en est de
constater que la raison n’est pas entièrement développée dans l’homme, et
qu’elle n’est pas uniformément répandue parmi eux. C’est donc par un troisième
moyen, qui initialement est un défaut ou une carence des sociétés que la nature
va contraindre les hommes d’une part à développer leurs facultés et d’autre
part les contraindre à entrer dans des relations de droit. Ce troisième moyen,
c’est l’insociable sociabilité, c’est à dire cette contradiction interne à la
vie sociale entre le besoin que nous avons des autres et le désir que nous
avons de défendre nos intérêts propres.
Le moyen dont la nature se
sert pour mener à bien le développement de toutes ses disposition est leur
antagonisme au sein de la Société, pour autant que celui-ci est cependant en
fin de compte la cause d’une ordonnance régulière de cette Société. –J’entends
ici par antagonisme l’insociable sociabilité des hommes c’est à dire leur
inclination à entrer en société, inclination qui est cependant doublée d’une
répulsion générale à le faire, menaçant constamment de désagréger cette
société.
En fait ce qui est originellement
un fauteur de trouble, un facteur de désordre, une entropie pourrait-on dire,
au sein de la société, va devenir le ferment de la perfectibilité. Les hommes
opposés les uns aux autres, éventuellement dans des luttes fratricides,
développent leurs talents et leurs facultés.
C’est cette résistance [celle des autres] qui
éveille toutes les forces de l’homme, le porte à surmonter son inclination à la
paresse, et, sous l’impulsion de l’ambition, de l’instinct de domination ou de
cupidité, à se frayer une place parmi ses compagnons qu’il supporte de mauvais
gré, mais dont il ne peut se passer. (…) Sans ces qualités d’insociabilité, (…)
les hommes, doux comme les agneaux qu’ils font paître, ne donneraient à
l’existence guère plus de valeur que n’en a leur troupeau domestique.(…) Sans
cela toutes les dispositions naturelles excellentes de l’humanité seraient
étouffées dans un éternel sommeil.
Mais aussi les luttes et les vengeances réciproques vont
contraindre les hommes, pour leur sécurité, à entrer dans une société de droit,
du type « contrat social ». Les luttes deviendront de plus en plus
cruelles et tels les Capulet et les Montaigue qui, sur les cadavres de leurs
enfant concluent la paix et fondent la prospérité commerciale de Vérone, c’est
par nécessité, à cause du prix du sang, que les adversaires d’hier veulent
s’unir.
[le premier but de la nature
à travers l’histoire humaine] c’est la réalisation d’une Société civile
administrant le droit de façon universelle (…)
ce n’est que dans une telle société que la nature peut réaliser son dessein
suprême, c’est à dire le plein épanouissement de toutes ses dispositions dans
le cadre de l’humanité
Mais une société de droit, isolée
dans un monde de barbarie ne pourrait survivre. Le même processus d’insociable
sociabilité règne entre nations.
Le problème de
l’établissement d’une constitution civile parfaite est lié au problème de
l’établissement de relations régulières entres les Etats, et ne peut pas être
résolu indépendamment de ce dernier.
Les guerres vont devenir de plus
en plus onéreuses, et personnes tuées ou mutilées et en biens détruit. L’effort
de guerre lui-même risque de venir ruiner la prospérité de la cité. Si bien
que, du XVIIIe siècle Kant formule cette prophétie : les nations ne
pourront plus faire autrement que de conclure des relations de paix entre
elles.
Ainsi par le moyen des
guerres, des préparatifs excessifs et incessants en vue des guerres et de la
misère qui s’ensuit intérieurement pour chaque Etat, même en temps de paix, la
nature, dans des tentatives d’abord imparfaites, puis finalement, après bien
des ruines, bien des naufrages, après même un épuisement intérieur radical de
leurs forces, pousse les Etats à faire ce que la raison aurait aussi bien pu
leur apprendre sans qu’il leur en coûtât d’aussi tristes épreuves, c’est à
sortir de l’état anarchique de sauvagerie, pour entrer dans une Société des
Nations.
Mais à ce parvenu à ce stade, les
hommes n’accèderont pas encore à la moralité. En effet, même si l’on peut
considérer que le premier impératif catégorique est satisfait par la
constitution d’une société des nations,
si donc la condition de l’universalité du droit est acquise, ceci n’est encore
que la moitié du projet de la nature dans l’Histoire. Car c’est poussés par la
nécessité que les hommes et les nations sont entrés dans des relations de
droit, non par vertu, c’est à dire par choix volontaire et raisonnable.
Tant que ce dernier pas
n’est point franchi, (à savoir l’association des Etats) , ce qui ne
représente guère qu’une moitié du développement pour la nature humaine, (…)
nous sommes hautement cultivés dans le domaine de l’art et de la science. Nous
sommes civilisés, au point d’en être accablés, pour ce qui est de l’urbanité et
des bienséances sociales de tout ordre. Mais quant à nous considérer comme déjà
moralisés, il s’en faut encore de beaucoup.
Seule la réalisation du deuxième
objectif de la nature dans l’histoire va satisfaire cette exigence. Elle prend
la forme du second impératif catégorique
Qu’est-ce que le règne des fins,
ce second but que la nature assigne à l’Histoire humaine ? C’est un état
de la société où la loi ne sera plus vue comme moyen de la paix, mais aimée
pour elle même, par devoir dicté par la raison, par accord raisonnable à une
valeur universelle. C’est aussi le moment où les hommes cesseront de se prendre
mutuellement pour les moyens de satisfaire les appétits de leur sensibilité
mais se considèreront mutuellement comme fin, c’est à dire comme des personnes
irremplaçables, comme des valeurs absolues et non des choses qui n’ont qu’un prix.
Ce n’est donc plus par nécessité
que les hommes aimeront la loi, mais par devoir. Avant de pouvoir adopter comme
leur devise « tu dois donc tu peux », on peut supposer que ces
hommes qui ont sauté le pas de la sauvagerie à la civilité auront encore besoin
de progresser dans les voies de la raison. C’est la mission que Kant confiera à
l’éducation, seule susceptible d’assurer le triomphe durable de la raison sur
la sensibilité.
Dans le règne des fins tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix
peut aussi bien être remplacé par quelque chose d’autre comme équivalent; ce
qui, au contraire, est supérieur à tout prix, qui, par suite, n’admet aucun
équivalent, c’est ce qui a une dignité.
Ce qui se rapporte aux inclinations et aux besoins humains généraux a un
prix marchand; ce qui, sans supposer de besoin, est conforme à un certain goût,
c’est-à-dire à une satisfaction venant du simple jeu sans but de nos facultés
mentales, a un prix de sentiment; mais ce qui constitue une condition de par
laquelle quelque chose peut être une fin en soi n’a pas uniquement une valeur
relative, c’est-à-dire un prix, mais une valeur intrinsèque, c’est-à-dire une
dignité.
Or la moralité est la condition sous laquelle seule un être raisonnable
peut être fin en soi; parce que ce n’est que par elle qu’il est possible d’être
membre législateur dans le règne des fins. Donc la moralité, et l’humanité en
tant qu’elle en est capable, c’est ce qui seul a de la dignité. L’habileté et
l’application au travail ont un prix marchand; l’esprit, l’imagination vive,
l’enjouement ont un prix de sentiment; au contraire, la fidélité à ses
promesses, la bienveillance selon des principes (et non par instinct) ont une
valeur intrinsèque.
KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs (1785)
2e section ; traduction
L.M. Morfaux
Que penser de ce bel espoir mis en l’Histoire humaine ?
Certes, le point de vue de Kant
est moins naïf que celui de Condorcet. Sa lecture des progrès de l’Histoire est
plus nuancée, même si l’on y retrouve la même foi quasi-mystique. Certes il
considère bien que la dimension du vouloir sera essentielle pour
pérenniser les acquis de la civilisation. Mais sur ce point, on peut se
demander s’il ne fait pas de l’angélisme
lorsqu’il croit à l’avènement du règne des fins. L’éducation suffira-t-elle à
convaincre les hommes de la bonté des leçons de la raison ? n’auront-il
pas toujours tendance à écouter les inclinations de leur sensibilité ?
Comment penser, en outre, que ce
qu’une génération voudra choisir pour elle-même, en tant que règle morale
conforme à son idéal de raison, pourra se transmettre aux générations futures,
sans qu’il soit besoin de l’imposer ?
Ce qui est enfin contestable
c’est que l’insociable sociabilité, si elle naît des conditions même de
l’existence sociale puisse être un jour éradiquée. Et d’autre part, si chaque
génération n’est pas elle-même confronté à la dualité entre intérêt propre et
intérêt commun, comment pourra-t-elle accéder à la moralité, si elle n’est pas
instruite par son propre choix ?
C’est par une inquiétude et un
vœu pieux que Kant clos son propos :
(…) la minutie, louable
sans doute, avec laquelle on rédige à présent l’histoire contemporaine, doit
malgré tout faire naître naturellement en chacun une inquiétude : celle de
savoir comment nos descendants éloignés s’y prendront pour soulever le fardeau
de l’histoire que nous pourrons leur laisser d’ici quelques siècles. Sans aucun
doute, ils apprécieront celle des temps les plus reculés, dont les documents se
seront perdu pour eux depuis longtemps, du seul point de vue de la contribution
ou du préjudice que les peuples et les régimes ont apporté sur le plan
cosmopolitique. Prendre garde à cela et tenir compte aussi tant de l’ambition
des chefs d’Etat que celle de leurs serviteurs, pour attirer leur attention sur
le seul moyen qu’ils ont de transmettre leur glorieux souvenir à la postérité,
voilà encore un petit motif supplémentaire pour tenter une telle histoire
philosophique.
3 – Hegel, le
« panthéisme historique »
|

G. W. F. Hegel
(1770-1831)
|
Il n’y a pas de héros pour son valet de chambre,
selon un proverbe connu; j’ai ajouté — et Goethe l’a redit dix ans plus tard
—
non parce que l’homme n’est pas un héros,
mais parce que l’autre est le valet de chambre.
L’homme libre n’est point envieux,
il admet volontiers ce qui est grand et sublime
et se réjouit que cela existe.
Comme pensée du monde, la philosophie paraît pour la
première fois dans le temps,
après que la réalité a achevé son processus de
formation et en est venue à bout.
Quand la
philosophie peint sa grisaille dans la grisaille,
une forme de la vie achève de vieillir, et avec du
gris sur du gris
elle ne se
laisse pas rajeunir mais seulement connaître :
l’oiseau de Minerve ne prend son vol qu’à la tombée
du crépuscule
|
La philosophie de l’Histoire de
Hegel est la première, parmi celles que nous étudions, à former un corpus
de proposition totalement achevé. Nous allons y trouver :
-
Un principe directeur (l’Esprit universel, ou l’Idée)
-
Un vecteur (le progrès de la liberté assimilé à celui
de la conscience de soi)
-
Une finalité (l’Absolu)
-
Des acteurs (Les grands hommes)
-
Des moyens (les passions)
-
Un modus operandi (la dialectique)
3.1 – L’Idée
Si nous parlions en titre de
« panthéisme historique » c’est qui nous semble que chez Hegel, si
l’idée de Dieu n’est pas explicite, au moins fait-il référence à l’Absolu,
terme de l’Histoire, mais aussi son commencement, et présent tout au long de
son développement. On retrouve ici l’affirmation d’un principe transcendant, à
la fois alpha et oméga, commencement et
fin qui guiderait la vie, puis l’humanité dans son développement.
Une image familière à Hegel rendrait bien compte de cette idée : celle du
germe qui est au commencement du développement de la plante, qu’il guide, et
présent également dans le terme de cette croissance, dans le germe que portent
les graines du fruit.
Semblable
à Mercure, le conducteur des âmes, l’Idée est en vérité ce qui mène les peuples
et le monde, et c’est l’Esprit, sa volonté raisonnable et nécessaire, qui a guidé
et continue de guider les événements du monde.
Hegel, La
raison dans l’Histoire (texte
de 1822
On peut donc à juste titre parler d’un principe sacré qui contiendrait en
puissance la totalité du développement de l’être dès son origine. Quel est la
nature de cet « être » ? « L ‘esprit » doit-il
être compris comme l’esprit des hommes, ou l’esprit de Dieu ? Dans d’autres textes, Hegel parle de « raison
universelle, de « génie de l’Univers », ou encore d’Idée ou de
Raison, avec une majuscule. Nous y verrons un principe qui transcende l’homme,
et qui anime tout aussi bien la vie que leur pensée. Cet esprit serait à
l’œuvre partout, ce qui justifie notre appellation de « panthéisme »
3.2
– Conscience de soi et liberté
Quel est le vecteur du progrès
historique ? Hegel l’identifie dans les progrès corrélatifs de la
conscience de soi et de la liberté. A propos du lien établi entre ces deux
concepts, on se réfèrera au cours sur autrui, 2.3 Autrui et la
reconnaissance de soi, p. 9-11
La
nature de l’esprit
se reconnaît à ce qui en est le parfait contraire. De même que la substance de
la matière est la pesanteur, nous devons dire que la substance, l’essence de
l’esprit est la liberté.
La matière est l’aliénation
absolue, puisqu’elle a son principe hors d’elle-même. Les choses matérielles,
un rocher par exemple, ne se meuvent que par l’attraction d’un autre corps, ou
encore lorsqu’elles subissent un choc extérieur. La matière ne manifeste
d’elle-même aucun dynamisme propre. Si la matière est aliénation, degré zéro de
la liberté, Hegel fait de l’esprit la réalisation la plus complète de la
liberté.
La matière est pesante en
tant qu’elle se dirige vers un centre; elle est essentielle ment complexe; elle
se trouve hors de l’unité et la cherche, elle cherche donc à s’anéantir
elle-même, elle cherche son contraire; si elle l’atteignait, elle ne serait
plus la matière, elle aurait disparu, elle tend à l’idéalité, car dans l’unité,
elle est idéale. L’esprit au contraire a justement en lui-même son centre; il
n’a pas l’unité hors de lui mais il l’a trouvée; il est en soi et avec soi. La
matière a sa substance en dehors d’elle; l’esprit es l’être-en-soi-même. Cela
est justement la liberté, car si je suis dépendant je me rapporte à autre chose
que je ne suis pas; je ne puis exister sans quelque chose hors de moi; je suis
libre quand je suis en moi.36
Déjà la vie conquiert une
relative indépendance par rapport à la matière, de par son expansion dynamique,
et plus tard, dans l’animalité, de part sa relative autonomie de mouvement.
Mais l’esprit humain devient lui-même en se détachant progressivement de ce qui
n’est pas lui, en passant du besoin au désir, puis du désir d’objet au désir de
désir ; la conscience de soi se libère lorsqu’elle tire son existence de
la reconnaissance d’une autre elle-même, d’une autre conscience de soi. Le
terme final serait un retour à l’absolu, où l’Esprit parvenu à un état de
réalisation suprême ne dépendrait plus que de lui-même pour être.
On remarquera donc, dans
l’extrait qui suit, que Hegel assimile progrès de la conscience de soi (effort
pour acquérir le savoir de ce qu’il est) et progrès de la conscience de
la liberté, ce qui est compréhensible, si nous admettons que la liberté est
véritablement l’essence de la conscience de soi.
D’après cette définition
abstraite, on peut dire de l’histoire universelle qu’elle est la représentation
de l’esprit dans son effort pour acquérir le savoir de ce qu’il est; et comme
le germe porte en soi la nature entière de l’arbre, le goût, la forme des
fruits, de même les premières traces de l’esprit contiennent déjà aussi
virtuellement toute l’histoire.
(…)L’histoire universelle
est le progrès dans la conscience de la liberté — progrès dont nous avons à
reconnaître la nécessité. 36
Mais concrètement, comment cette
progression de l’Esprit dans le temps se traduit-elle, dans l’Histoire des
hommes ? Hegel distingue trois périodes :
-
Les orientaux
-
Les Grecs
-
Le Christianisme
Les Orientaux ne savent pas
encore que l’esprit ou l’homme en tant que tel est en soi libre; parce qu’ils
ne le savent pas, ils ne le sont pas; ils savent uniquement qu’un seul est
libre; c’est pourquoi une telle liberté n’est que caprice, barbarie,
abrutissement de la passion ou encore douceur, docilité de la passion qui n’est
elle-même qu’une contingence de la nature ou un caprice. — Cet Unique n’est
donc qu’un despote et non un homme libre. 36
Par « orientaux » il
faut entendre les grandes tyrannies pharaoniques ou mésopotamiennes. Là, en
apparence règne le despotisme et l’aliénation des peuples. Mais un germe de la
liberté existe car au moins un homme est libre, le tyran lui-même, et avec lui
ses courtisans. Cependant cette liberté repose sur la force, qui n’est qu’une
contingence. Car la
force, ou l’héritage d’une richesse ou d’un pouvoir peuvent aussi bien se
perdre, le tyran peut devenir le dernier des esclaves ; de même la liberté
du courtisan est entièrement dépendante du bon vouloir du Prince.
Chez les Grecs s’est d’abord
levée la conscience de la liberté, c’est pourquoi ils furent libres, mais eux,
aussi bien que les Romains savaient seulement que quelques-uns sont libres, non
l’homme, en tant que tel. Cela, Platon même et Aristote ne le savaient pas;
c’est pourquoi non seulement les Grecs ont eu des esclaves desquels dépendait
leur vie et aussi l’existence de leur belle liberté; mais encore leur liberté
même fut d’une part seulement une fleur, due au hasard, caduque, renfermée en
d’étroites bornes et d’autre part aussi une dure servitude de ce qui
caractérise l’homme, de l’humain. 36
Les Grecs sont réputés avoir
inventé la démocratie. Seulement, l’égalité s’entendait à Athènes uniquement
entre citoyens et ceux-ci
pouvaient d’autant plus se consacrer aux arts nobles que les esclaves
travaillaient pour eux et produisaient les ressources nécessaires à leur
liberté. Aristote considère l’esclave comme faisant partie du
« mobilier » d’une maison.
Le germe de la liberté s’est donc développé chez eux, mais ne s’étend pas à
l’humanité tout entière. Leur liberté ne survivra pas à l’invasion des
Barbares. Athènes Sparte et Rome ont
péri et avec elles leur liberté qu’elles croyaient éternelles.
Seules les nations germaniques
sont d’abord arrivées dans le Christianisme, à la conscience que l’homme en
tant qu’homme est libre, que la liberté spirituelle constitue vraiment sa
nature propre; cette conscience est apparue d’abord dans la religion, dans la
plus intime région de l’esprit; mais faire pénétrer ce principe dans le monde,
était une tâche nouvelle dont la solution et l’exécution exigent un long et
pénible effort d’éducation. Ainsi, par exemple, l’esclavage n’a pas cessé
immédiatement avec l’adoption du christianisme; encore moins la liberté
a-t-elle aussitôt régné dans les États et les gouvernements et constitutions
ont-ils été rationnellement organisés ou même fondés sur le principe de
liberté. Cette application du principe aux affaires du monde, la transformation
et la pénétration par lui de la condition du monde, voilà le long processus qui
constitue l’histoire elle-même. 36
Par nations germaniques, il faut
entendre les peuples qui proviennent de l’éclatement du « Saint Empire
Romain Germanique » en gros, l’occident chrétien. En quoi peut-on dire du
christianisme qu’il a introduit dans la pensée humaine l’idée d’une
universalisation de l’idée d’homme ? C’est que l’un des enseignements du
Christ c’est que les hommes sont frères ; à plusieurs moments dans les
évangiles ce principe est affirmé comme le fondement du dogme chrétien :
les hommes sont fils de Dieu, et frères en Jésus Christ
Notons avec Hegel que ce progrès
en idée ne suffit pas ; pour qu’il entre dans le concret de l’Histoire, il
faudra qu’il passe du plan de l’esprit à celui du politique : ce que
réalisera une première fois la révolution de 1789, dans la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen, puis par l’abolition de l’esclavage.
Pour Hegel l’histoire est donc la
réalisation de l’essence de l’esprit, humain et universel, la réalisation de la
liberté. Mais quels en sont les acteurs ?
3.3 – Les grands
hommes de l’histoire
Les grands hommes de l’histoire sont ceux dont
les fins particulières renferment le facteur substantiel qui est la volonté du
génie universel. On doit les nommer des héros en tant qu’ils ont puisé leurs
fins et leur vocation non seulement dans le cours des événements, tranquille,
ordonné, consacré par le système en vigueur mais à une source dont le contenu
est caché, et n’est pas encore parvenu à l’existence actuelle, dans l’esprit
intérieur, encore souterrain qui frappe contre le monde extérieur comme à un
noyau et le brise parce qu’il n’est pas l’amande qui convient à ce noyau ; ils
semblent donc puiser en eux-mêmes et leurs actions ont produit une situation et
des conditions mondiales qui paraissent être uniquement leur affaire et leur
oeuvre.
Le grand homme, pour Hegel, n’est pas le philosophe,
celui qui a conscience de l’Idée, mais l’homme politique, le guerrier,
l’inventeur, bref, celui qui est engagé dans le concret de l’histoire ; il
n’a peut-être pas conscience du terme ultime où mène l’histoire humaine, mais
du terme proche, de celui qui sera son œuvre.
De tels individus n’avaient
pas, en ce qui concerne leurs fins, conscience en général de l’Idée; mais ils
étaient des hommes pratiques et politiques. C’étaient aussi des gens qui
pensaient et qui savaient ce qui est nécessaire, et ce dont le moment est venu.
C’est à savoir la vérité de leur temps et de leur monde, pour ainsi parler, la
race prochaine qui existait déjà intérieurement. C’était leur affaire de
connaître cette valeur générale, l’échelon nécessaire, prochain, de leur
univers, d’en faire leur fin, d’y consacrer leur énergie.
Ils sont « les hommes
d’affaires » du génie de l’univers, on pourrait même dire « les
hommes de mains » car ce sont eux qui feront « la sale besogne »
En croyant souvent poursuivre leurs intérêts particuliers, ils se mettent au
service de l’histoire, presque à leur insu. Ils sont des conducteurs d’âmes,
car ils ont la prescience de ce qui est le meilleur de leur temps. S’ils sont
suivis c’est qu’ils n’inventent pas véritablement l’Idée : elle est
présente chez tous de manière inconsciente : ils en sont les révélateurs.
C’est pourquoi les hommes de
l’histoire universelle, les héros d’une époque, doivent être reconnus comme les
sages; leurs actes, leurs discours sont ce qu’il y a de mieux à leur époque. De
grands hommes ont voulu, pour se satisfaire, non pour les autres. Ce qu’ils
auraient appris des autres en fait de desseins et de conseils bien
intentionnés, aurait été, au contraire, plus borné et plus faux; car ils
savaient le mieux ce dont il s’agissait; et cela les autres l’ont ensuite bien
plutôt appris d’eux et l’ont trouvé bon d’après eux, ou s’y sont pour le moins
accommodés. Car l’esprit qui va plus avant, c’est l’âme intérieure de tous les
individus, mais l’intériorité inconsciente que les grands hommes leur rendent
consciente. C’est pourquoi les autres suivent ces conducteurs d’âmes, car ils
éprouvent la puissance irrésistible de leur propre esprit intérieur qui vient à
leur rencontre.
Notons que nous pourrions étendre la conception du grand
homme aux artistes et surtout aux « capitaines d’industrie », qui
dans le libéralisme naissant du XIXe siècle vont aussi bouleverser concrètement
leur époque. Eux aussi ne seront pas directement compris de leurs contemporains
et échoueront sur le plan de la réussite privée ; il n’empêche que ces
visionnaires vont opérer dans leur temps des transformations durables, que
d’autre, après eux n’auront plus qu’à louer.
Si, allant plus loin, nous
jetons un regard sur la destinée de ces individus historiques qui avaient pour
vocation d’être des hommes d’affaires du génie de l’Univers, nous constaterons
qu’elle ne fut pas heureuse. Ils n’en vinrent pas à une paisible jouissance,
toute leur vie ne fut que labeur et peine, toute leur nature ne fut que leur
passion. La fin atteinte, ils tombent, balle vide du grain. Ils meurent tôt
comme Alexandre, ils sont assassinés comme César, déportés à Sainte-Hélène,
comme Napoléon.
HEGEL, Leçons sur la philosophie de l’histoire,
Introduction, éd. Vrin, pp. 34-36.
La vie du grand homme est
entièrement dans son œuvre. Il est entièrement consumé par elle, ce qui fait de
sa vie une véritable passion. Cette conception romantique du héros est
exaltante, et convient aussi à qualifier des grandes destinées postérieures à
Hegel.
Soulignons tout de même le
problème que pose cette conception romantique du rôle du grand homme. Qu’est-ce
qui distinguera le héros positif du « héros négatif », de celui qui
va se proclamer porteur du destin de l’humanité dans un délire mégalomaniaque.
Peut-on sur ce point se reporter au « jugement de l’histoire » ?
Mais nous nous heurtons sur ce point à une autre difficulté : après tout,
l’une des conséquences du nazisme fut, à sa chute, la déclaration universelle
des droits de l’homme (1948) Faut-il voir en ses chefs les héros négatifs
nécessaires à l’avancée de cette idée dans l’histoire ?
César devait accomplir le
nécessaire et donner le coup de grâce à la liberté moribonde. Lui-même a péri
au combat, mais le nécessaire demeure : la liberté selon l’idée se réalise
sous la contingence extérieure.
3.4
– Les passions – la ruse de la raison universelle
Cependant, si les idées mènent le
monde, elles sont d’abord des abstractions. Or les hommes ne sont pas des
abstractions : ils ont des appétits matériels et sensibles, ce sont des
hommes de chair et d’os, sujet à des passions. Car l’individu est un existant; ce n’est pas l’«
homme en général », celui-ci n’existant pas, mais un homme déterminé.
Qu’est-ce qui peut bien convaincre de tels hommes de se mettre au service d’un
dessein désintéressé ?
La passion est tenue pour
une chose qui n’est pas bonne, qui est plus ou moins mauvaise : l’homme ne doit
pas avoir des passions. Mais passion n’est pas tout à fait le mot qui convient
pour ce que je veux désigner ici. Pour moi, l’activité humaine en général
dérive d’intérêts particuliers, de fins spéciales ou, si l’on veut,
d’intentions égoïstes, en ce sens que l’homme met toute l’énergie de son
vouloir et de son caractère au service de ces buts en leur sacrifiant tout ce
qui pourrait être un autre but, ou plutôt en leur sacrifiant tout le reste. Ce
contenu particulier coïncide avec la volonté de l’homme au point qu’il en
constitue toute la détermination et en est inséparable c’est par là qu’il est
ce qu’il est. (…)Le mot « caractère » exprime aussi cette détermination
concrète de la volonté et de l’intelligence (...).
Hegel distingue deux sortes de
passions : les passions privées, qui ont pour but la satisfactions des intérêts
propres des individus ; il réserve à cette sorte de passion le nom de
« caractère ». On retiendra cependant de cette première forme de
passion la capacité à consacrer toutes ses forces en vue d’une fin. C’est sur la nature de cette fin que passion
se distingue du simple caractère : lorsque, à l’insu même du passionné,
les conséquences de sa passion dépassent la simple sphère personnelle :
Je dirai donc passion,
entendant par là la détermination particulière du caractère dans la mesure où
ces déterminations du vouloir n’ont pas un contenu purement privé, mais
constituent l’élément actif qui met en branle les actions universelles
(...).Nous disons donc que rien ne s’est fait sans être soutenu par l’intérêt
de ceux qui y ont collaboré. Cet intérêt, nous l’appelons passion lorsque,
refoulant tous les autres intérêts ou buts, l’individualité tout entière se
projette sur un objectif avec toutes les fibres intérieures de son vouloir et
concentre dans ce but ses forces et tous ses besoins. En ce sens, nous devons
dire que rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion.
Les passions sont donc, comme
jadis chez Rousseau et chez Kant, le ferment qui permet les grandes
réalisations de l’humanité. Ceci n’est pas dit seulement de l’histoire
politique mais aussi de l’art, de la science des techniques. Les passions sont
cette faculté de l’homme de se dépasser lui-même, lorsque son désir vise bien
au-delà de la satisfaction, au delà du plaisir personnel.
On peut appeler ruse de la
Raison le fait que celle-ci laisse agir à sa place les passions, en sorte que
c’est seulement le moyen par lequel elle parvient à l’existence qui éprouve des
pertes et subit des dommages. […] Le particulier est trop petit en face de
l’Universel : les individus sont donc sacrifiés et abandonnés. L’idée paie
le tribut de l’existence et de la caducité non par elle-même, mais au moyen des
passions individuelles.
Hegel, La raison dans l’histoire, 1830, trad. K. Papaioannou, U.G.E., coll. 10/18, p. 108 et 129
Ici aussi, ce sont les hommes qui
font leur histoire, mais bien souvent aux dépens de leurs propres intérêts. Si
elle n’était trop triviale, l’image de la carotte et de l’âne conviendrait
assez bien pour désigner cette ruse de la raison universelle. Les hommes, sans
le savoir, se mettent au service d’un dessein qu’ils ignorent et qui progresse nécessairement
vers son terme absolu.
3.5
– La dialectique
Il nous reste à présent à décrire
le modus operandi de l’Histoire la progression dialectique.
La dialectique hégélienne se
différencie de la dialectique platonicienne en ceci qu’elle ne procède pas
seulement par contradictions dépassement de ces contradictions, mais parce
qu’elle accorde à chaque membre de la contradiction un statut de nécessité.
D’autant plus rigidement la
manière commune de penser conçoit l’opposition mutuelle du vrai et du faux,
d’autant plus elle a coutume d’attendre dans une prise de position à l’égard
d’un système philosophique donné, ou une concordance, ou une contradiction, et
dans une telle prise de position elle sait seulement voir l’une ou l’autre.
Elle ne conçoit pas la diversité des systèmes philosophiques comme le
développement progressif de la vérité; elle voit plutôt seulement la
contradiction dans cette diversité. Le bouton disparaît dans l’éclatement de la
floraison, et on pourrait dire que le bouton est réfuté par la fleur : à
l’apparition du fruit, également, la fleur est dénoncée comme un faux être-là
de la plante, et le fruit s’introduit à la place de la fleur comme sa vérité.
Ces formes ne sont pas seulement distinctes, mais encore chacune refoule
l’autre, parce qu’elles sont mutuellement incompatibles. Mais en même temps
leur nature fluide en fait des moments de l’unité organique dans laquelle elles
ne se repoussent pas seulement, mais dans laquelle l’une est aussi nécessaire
que l’autre, et cette égale nécessité constitue seule la vie du tout. Au
contraire, la contradiction à l’égard d’un système philosophique n’a pas
elle-même coutume de se concevoir de cette façon; et, d’autre part, la conscience
appréhendant cette contradiction ne sait pas la libérer ou la maintenir libre
de son caractère unilatéral; ainsi dans ce qui apparaît sous forme d’une lutte
contre soi-même, elle ne sait pas reconnaître des moments réciproquement nécessaires.
Friedrich HEGEL, La
phénoménologie de l’esprit (1807).
Le processus
dialectique peut être décrit dans le schéma suivant :
 A B
A B
 C D
C D
 E F
E F
N... etc.
Nous pouvons, pour comprendre le schéma l’appliquer à
l’histoire des institutions politiques au XVIIIe et XIX siècles. A la monarchie
absolue (A) s’oppose les idéaux révolutionnaires (B) qui vont aboutir aux
monarchies constitutionnelles (C), qui vont à leur tour s’opposer aux idéaux
républicains de 1848 (D) ce qui va provoquer le retour du seconde empire,
d’abord sous sa forme absolutiste puis parlementaire (E), à son tour mis à mal
par la commune (N)...
L’intérêt du schéma hégélien,
c’est qu’il peut s’appliquer à la description de tout progrès. Il convient
particulièrement à la représentation du progrès dans les sciences : chaque
étape du savoir rencontre à un moment de son développement une thèse qui va
venir contredire partiellement ce que l’on tenait pour vrai. Mais la première
des théories n’est pas seulement ce qui va être tenu par la suite pour faux.
Elle est nécessaire pour que la l’antithèse contradictoire puisse apparaître,
et que la synthèse des deux théories puisse se faire.
Le schéma formel de la
dialectique hégélienne sera repris par Marx comme nous allons le voir ci-après.
Que penser de cette vision
prophétique de l’Histoire que nous présente Hegel ?
D’abord relever qu’elle est
enthousiasmante, car elle assigne à l’humanité un but élevé qui n’est rien
d’autre que le retour au sein de l’absolu qui la fonde. On pourrait presque y
voir une tentative de concilier le christianisme et l’humanisme : l’homme
à travers son histoire irait vers Dieu, source de son être, et présent à tout
moment de son développement.
On verra plus loin la critique
que Marx fait de Hegel (l’inversion de l’image de l’histoire), et nous
pourrions relever avec lui que l’hégélianisme est la théorie de philosophie de
l’histoire qui convient bien au libéralisme du XIXe siècle, en tant qu’il porte
l’accent sur le rôle des idées (ce sont les idées qui mènent le monde),
à cause aussi du rôle qu’y jouent les « grands hommes de l’histoire »,
qui anticipent sur les grandes figures du libéralisme que sont les
entrepreneurs, les « capitaines d’industrie ».
Une lecture récurrente de
l’Histoire nous impose tout de même une autre critique. Au pays de Kant et de
Hegel va naître au XXe siècle une idéologie et une pratique politiques qui ne semblent aller ni dans le
sens de la civilisation, ni dans celui de la reconnaissance de l’universalité
de l’idée d’homme, ni encore moins dans celui du progrès de la liberté ou du
triomphe de l’esprit. C’est au pays de Schiller, Kant et de Beethoven, c’est
dans la langue de
Goethe, de Schubert et d’Einstein
que va se formuler l’idéologie la plus destructrice de l’homme, le nazisme.
Si bien qu’on peut se demander si
l’optimisme de Hegel n’est pas dangereux. Peut-on penser que l’Esprit arrivera
à ses fins, au dépens de la volonté des hommes ? Peut-on ne voire dans les
errements de l’histoire que des épisodes passagers, à reprendre dans une
conception plus large du devenir historique ? Les acquis indéniables de la
réflexion morale ou philosophique nous prémunissent-ils de la folie des
hommes ? On pourrait toujours objecter à Hegel que Socrate énonçait déjà
que la seule patrie digne d’être habitée par les hommes était celle de
l’esprit, on pourrait penser que les condamnations iniques de Socrate et de
Jésus ne devraient jamais se reproduire dans l’histoire, on pourrait mettre en
face des bourreaux des innocents tous les Gandhi et Lutter King de l’Histoire,
pour lui montrer que rien ne nous protège du reflux brutal de l’inhumain contre
l’humain.
4 – Marx :
« producteurs, sauvons nous nous-même ! »
|

Karl Marx
(1818-1883)
|
L’histoire de toute société jusqu’à nos jours
n’a été que l’histoire de luttes de classes
Homme libre et esclave, patricien et plébéien,
baron et serf, maître de jurande et compagnon,
en un mot oppresseurs et opprimés en opposition
constante,
tantôt ouverte, tantôt dissimulée,
une guerre qui finissait toujours
soit par une transformation révolutionnaire de la
société tout entière,
soit par la destruction des deux classes en lutte.
(…)
Les communistes
ne s’abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets
Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent
être atteints que par le renversement violent de tout l’ordre social passé.
Que les classes dirigeantes tremblent à l’idée d’une
révolution communiste ! Les prolétaires n’y ont rien à perdre que leurs
chaînes.
Ils ont un monde à y gagner.
PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS
Karl Marx, Friedrich Engels,
Manifeste du parti communiste (1848)
|
La volonté de Marx est de fonder
sa théorie de philosophie de l’histoire comme une science, et non comme une
réflexion métaphysique ou idéologique. Pour lui, l’étude des faits, des
constats matériels et historiques, est donc plus importante que les
spéculations intellectuelles que l’on peut faire sur l’histoire.
4.1 – Le matérialisme
historique
|
La condition première de toute histoire humaine
est naturellement l’existence d’êtres humains vivants. Le premier état de
fait à constater est la complexion corporelle de ces individus et les
rapports qu’elle leur crée avec le reste de la nature.
On peut distinguer les hommes des
animaux par la conscience, par la religion et par tout ce que l’on voudra. Eux-mêmes
commencent à se distinguer des animaux dès qu’ils commencent à produire leurs moyens d’existence, pas
en avant qui est la conséquence même de leur organisation corporelle. En
produisant leurs moyens d’existence, les hommes produisent indirectement leur
vie matérielle elle-même.
|
Si
Hegel considérait que la dimension première de l’homme est celle de la
pensée, Marx veut faire partir toute étude de l'Histoire humaine des
caractéristiques qui lui reviennent en tant qu’être vivant.
Cette
dimension fondamentale c’est le travail, la nécessité de produire d’eux même
leurs moyens d’existence.
Le
« On peut » relève de l’idéologie. Le « Eux-mêmes »
relève de l’observation empirique
|
|
La façon dont les hommes produisent leurs moyens
d’existence dépend d’abord de la nature des moyens d’existence déjà donnés.
et qu’il leur faut reproduire. Il ne faut pas considérer ce mode de production
de ce seul point de vue, à savoir qu’il est la reproduction de l’existence
physique des individus. Il représente plutôt déjà un mode déterminé de
l’activité de ces individus, une façon déterminée de manifester leur vie, un
mode de vie déterminé. La façon dont les individus manifestent leur vie
reflète très exactement ce qu’ils sont. Ce qu’ils sont coïncide donc avec
leur production, aussi bien avec ce qu’ils produisent qu’avec la façon dont
ils le produisent.
|
Pour
Marx, il faut donc considérer l’homme et sa société à partir de leur
insertion dans le monde, dans la nature. Celle ci va conditionner la manière
dont ils travaillent, d’un point de vue très concret, tant en ce qui concerne
les moyens de production ( outils, techniques etc.) que l’organisation du
travail.
Ce
point de départ est donc matérialiste, car il repose d’abord sur
l’observation de la condition matérielle des hommes au sein de la nature
|
|
(…)
Voici donc les faits : des individus déterminés
qui ont une activité productive selon un mode déterminé entrent dans des
rapports sociaux et politiques déterminés. Il faut que dans chaque cas isolé,
l’observation empirique montre dans les faits, et sans aucune spéculation ni
mystification, le lien entre la structure sociale et politique et la
production. La structure sociale et l’État résultent constamment du processus
vital d’individus déterminés; mais dé ces individus non point tels qu’ils
peuvent s’apparaître dans leur propre représentation ou apparaître dans celle
d’autrui, mais tels qu’i1s sont en réalité, c’est-à-dire, tels qu’ils
oeuvrent et produisent matériellement; donc tels qu’ils agissent sur des
bases et dans des conditions et limites matérielles déterminées et indépendantes
de leur volonté.
|
L’homme
réel est donc pour Marx le producteur. Toute la structure de la société est
le reflet de cette condition matérielle ; le philosophe doit donc
essentiellement constater le lien entre telle structure sociale et politique
et son origine matérielle dans la production des moyens d’existence.
On
voit apparaître cette idée que l’histoire ne se fait pas où les hommes ont
l’illusion qu’elle se fait, mais à un niveau qui échappe à leur conscience et
leur volonté.
|
|
La production des idées, des
représentations et de la conscience est d’abord directement et intimement
mêlée à l’activité matérielle et au commerce matériel des hommes, elle est le
langage de la vie réelle. Les représentations, la pensée, le commerce
intellectuel des hommes apparaissent ici encore comme l’émanation directe de
leur comportement matériel. Il en va de même de la production intellectuelle
telle qu’elle se présente dans la langue de la politique, celle des lois, de
la morale, de la religion, de la métaphysique, etc. de tout un peuple. Ce
sont les hommes qui sont les producteurs de leurs représentations, de leurs
idées, etc., mais les hommes réels, agissants, tels qu’ils sont conditionnés
par un développement déterminé de leurs forces productives et des rapports
qui y correspondent, y compris les formes les plus larges que ceux-ci peuvent
prendre. La conscience ne peut jamais être autre chose que l’être conscient
et l’être des hommes est leur processus de vie réel. Et si, dans toute
l’idéologie, les hommes et leurs rapports nous apparaissent placés la tête en
bas comme dans une camera obscura, ce phénomène découle de leur processus de
vie historique, absolument comme le renversement des objets sur la rétine
découle de son processus de vie directement physique.
|
De
même, les productions idéologiques (philosophie, sciences, morale, religion,
art etc… sont selon Marx directement liée à la base matérielle de la société.
Les
hommes sont donc bien les producteurs de leurs idées, mais des hommes qui
sont en grande partie conditionnés par leurs conditions matérielles
d’existence.
L’idéologie
allemande (on peut ici penser à Hegel ou Feuerbach) ne peut faire autrement
que de se tromper dans la représentation de l’homme. Elle le représente la
tête en bas, selon un processus qui est lié aux besoins de la société
libérale naissante, qui a besoin de faire croire que ce sont les idées qui
mènent le monde, de la même façon que l’inversion de l’image sur la rétine
est liée à un processus optique, une loi de la physique.
|
|
à
l’encontre de la philosophie allemande qui descend du ciel sur la terre,
c’est de la terre au ciel que l’on monte ici. Autrement dit, on ne part pas
de ce que les hommes disent, s’imaginent, se représentent, ni non plus de ce
qu’ils sont dans les paroles, la pensée, l’imagination et la représentation
d’autrui, pour aboutir ensuite aux hommes en chair et en os; non, on part des
hommes dans leur activité réelle, c’est à partir de leur processus de vie
réel que l’on représente aussi le développement des reflets et des échos
idéologiques de ce processus vital. Et même les fantasmagories dans le
cerveau humain sont des sublimations résultant nécessairement du processus de
leur vie matérielle que l’on peut constater empiriquement et qui repose sur
des bases matérielles. De ce fait, la morale, la religion, la métaphysique et
tout le reste de l’idéologie, ainsi que les formes de conscience qui leur
correspondent, perdent aussitôt toute apparence d’autonomie. Elles n’ont pas
d’histoire, elles n’ont pas de développement; ce sont au contraire les hommes
qui, en développant leur production matérielle et leurs rapports matériels,
transforment, avec cette réalité qui leur est propre, et leur pensée et les
produits de leur pensée. Ce n’est pas la conscience qui détermine la vie,
mais la vie qui détermine la conscience. Dans la première façon de considérer
les choses, on part de la conscience comme étant l’individu vivant, dans la
seconde façon, qui correspond à la vie réelle, on part des individus réels et
vivants eux-mêmes et l’on considère la conscience uniquement comme leur
conscience.
Karl Marx, Friedrich Engels, L’Idéologie allemande (1845),
1ère partie, trad. Cartelle et
Badia, Éd. Sociales, 1965, pp. 18-37.
|
La
lecture que fait l’idéologie allemande de l’historie humaine est donc d’une
certaine manière un mensonge.
Il
n’y a pas d’histoire des idées, pas d’histoire de l’art et des sciences, ou
du moins pas d’histoire que l’on puisse penser indépendamment de l’histoire
réelle (économique) de la société.
La
conscience est donc un produit historiquement déterminé. Par exemple, on peut
penser que le philosophe lui-même n’échappe pas à cette détermination.
Rousseau est le philosophe dont la classe bourgeoise a besoin à la fin du
XVIIIe siècle pour faire aboutir un certain nombre de réformes :
reconnaissance de la liberté individuelle, de la propriété et, au delà, de la
liberté d’entreprendre. Mais Rousseau n’eût pas été possible une centaine
d’années auparavant. Le Philosophe de la fin du règne du Louis XIV, c’est
Montesquieu.
|
On peut représenter le
matérialisme historique par le tableau ci-dessous :
|
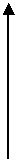
|
Superstructure
idéologique
|
Conceptions philosophiques, métaphysiques
Arts et sciences
Mentalités, us et coutumes, mythes
|
Niveau
conscient
|
|
|
Structure
Juridique, sociale et politique
|
Répartition et organisation du pouvoir
Divisions sociales (classes, castes, ordres,
clans)
Droit de propriété ; règles juridiques et
sociales
|
|
|
Infrastructure
économique
|
Répartition de la richesse produite, échanges
Divisions et organisation du travail
Moyens de production : techniques, outils
|
Niveau inconscient
|
|
|
|
Nature
|
|
Ce que résume Marx dans cet autre texte de 1859
Le résultat général auquel j’arrivai et qui, une fois acquis, servit à
mes études de fil conducteur, peut brièvement se formuler ainsi : dans la production
sociale de leur existence, les hommes entrent dans des rapports déterminés,
nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui
correspondent à un degré déterminé de développement de leurs forces productives
matérielles. L’ensemble de ces rapports de production constitue la structure
économique de la société, la base réelle sur laquelle s’élève une
superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de
conscience sociale déterminées6. Le mode de production de la vie
matérielle conditionne le processus de vie social, politique et spirituel en
général. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais, à
l’inverse, c’est leur être social qui détermine leur conscience.
Contribution
à la critique de l’économie politique, 1859,
Préface, trad. L.M. Morfaux,
cf. Marx/Engels,
Etudes philosophiques, Editions Sociales, pp. 121-122
4.2 Le
matérialisme dialectique
Jusqu’à présent, nous n’avons exposé qu’une
stratification de la société. Mais ceci ne nous dit pas comment se fait le
changement au sein de l’histoire, en particulier comment on passe d’un type de
société à un autre. Marx va emprunter à Hegel la structure dialectique et après
l’avoir remise sur ses pieds nous propose l’explication suivante :
A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles
de leur société entrent en contradiction avec les rapports de production
existants ou, ce qui n’en est que l’expression juridique, avec les rapports de
propriété au sein desquels elles avaient évolué jusqu’alors. De formes de
développement des forces productives qu’elles étaient, elles en deviennent des
entraves. Alors commence une ère de révolution sociale.
Le plus simple pour comprendre l’analyse de
Marx est de l’appliquer à un exemple historique précis, celui de la révolution
française de 1789.
En termes
hégéliens, la cause première de la révolution serait à rechercher au niveau des
idées, puis des passions individuelles des hommes. Les idées sont celles des
philosophes des lumières et de Jean Jacques Rousseau ; les passions se
sont celles d’hommes politiques ou de guerriers tels Robespierre ou Napoléon.
En revanche, selon
Marx, la cause de cette révolution est à rechercher dans la contradiction entre
les forces matérielles vives de la société de la fin du XVIIIe siècle,
essentiellement la bourgeoisie et une partie de la noblesse désireuse de
développer le commerce et l’industrie, et le type d’organisation des échanges
et du droit propre à la France du XVIIIe.
Cette organisation
juridique et économique était héritée de la féodalité. On peut la résumer en
disant qu’elle correspondait à un pays essentiellement rural, vivant en
autarcie, et où les échanges étaient entravés par des cloisonnements internes
au pays. Pas de liberté du commerce, pas de reconnaissance du droit de
propriété, ni de liberté d’entreprendre,
une structuration corporatiste du travail, convenant à des entreprises
artisanales, mais peu adaptées à la création de manufactures.
Il fallait donc,
pour libéraliser l’économie faire sauter le verrou de la vieille société. La
révolution de 1789, contrairement à son imagerie populaire fut, non une
révolution prolétarienne
mais une révolution bourgeoise. D’ailleurs, pour aller dans le sens d’une
analyse marxiste, nous devons bien relever que ce n’est pas au niveau des
grands principes révolutionnaires que se fait le changement entre l’ancien
régime et le nouveau : les ouvriers du XIXe siècle ne sont ni plus libres,
ni plus égaux ni plus frères que les paysans du XVIIIe. En revanche, la France
va réaliser au XIXe siècle sa révolution industrielle.
En même temps que s’opère la transformation de ta base économique
toute l’énorme superstructure est plus ou moins rapidement bouleversée. En
considérant de tels bouleversements on doit toujours distinguer entre le
bouleversement matériel des conditions économiques de production, constatable
avec une exactitude scientifique, et les formes politiques, religieuses,
artistiques ou philosophiques, bref, les formes idéologiques au sein desquelles
les hommes prennent conscience de ce conflit et le soutiennent jusqu’au bout.
Pas plus qu’on ne juge de ce qu’est un individu sur l’idée qu’il se fait de lui-même,
on ne saurait davantage juger une telle époque de bouleversement sur sa
conscience de soi, mais on doit bien plutôt expliquer cette conscience par les
contradictions de l’existence matérielle, par le conflit existant entre les
forces productives sociales et les rapports de production.
L’idéologie n’est
donc pas le moteur de l’histoire, elle en est le produit, le discours à travers lequel les hommes se représentent
leurs actions, ou les justifient. Il serait vain de mettre les idées en avant
pour faire avancer l’histoire : c’est ce que Marx reprochera aux
socialistes « utopistes » français du XIXe (Fourier, Proudhon,
Saint-Simon) ou aux anarchistes (Max Stirner, qu’il appelle méchamment
« Sancho » -le valet de l’illusion !-) : on ne fait pas de
révolution avec des mots, et même si l’intellectuel a un rôle à jouer auprès
des masses, ce ne peut être qu’un rôle d’accélérateur de l’histoire, mais non
pas celui du guide spirituel.
Un type de société (Gesellsçhaftsformation) ne disparaît jamais avant
que ne soient développées toutes les forces productrices qu’elle est assez
vaste pour contenir, et jamais des rapports de production nouveaux et
supérieurs ne s’y substituent avant que les conditions matérielles d’existence
de ces rapports n’aient achevé de couver dans le sein de la vieille société.
C’est pourquoi l’humanité ne se pose jamais que les problèmes qu’elle peut
résoudre, car, à y regarder plus près, il se trouvera toujours que le problème
lui-même ne surgit que là où les conditions matérielles de leur solution
existent déjà ou sont en cours de devenir.
Marx confirme ici l’idée du déterminisme
historique : l’histoire sécrète d’elle-même les moyens de sortir de ses
contradictions. Ainsi la forme contradictoire propre à l’époque de Marx, la
contradiction entre capital et travail est vouée selon lui à disparaître, car
elle porte en elle les ferments de sa disparition ; en effet, en
provoquant des concentrations de main d’œuvre dans les villes, en créant des
manufactures, la bourgeoisie rend possible la constitution d’une classe
ouvrière. L’histoire du monde ouvrier au XIXe et XXe siècle donnerait raison à
Marx sur ce point. Ce que les
compagnons ne pouvaient faire, car séparés par l’organisation corporatiste du
travail, les ouvriers vont pouvoir le réaliser ; ils vont accéder à la
conscience de classe, c’est à dire se rendre compte qu’ils ont des intérêts
communs et que ces intérêts sont opposés à ceux du patronat ; ils vont
aussi se rendre compte qu’ils représentent une force économique qu’ils pourront
faire valoir dans une conflit.
Dans leurs grands traits les modes de production asiatiques, antiques,
féodaux et bourgeois modernes peuvent être caractérisés comme des époques
progressives du régime économique de société. Les rapports bourgeois de
production sont la dernière forme antagoniste du processus social de
production, non point au sens d’un antagonisme individuel, mais d’un
antagonisme qui naît des conditions sociales d’existence des individus ;
cependant les forces productives qui se développent au sein de la société
bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles pour la solution de
cet antagonisme. Avec cette forme de société s’achève donc la préhistoire de la
société humaine.
Contribution
à la critique de l’économie politique, 1859,
Préface, trad. L.M. Morfaux,
cf. Marx/Engels,
Etudes philosophiques, Editions Sociales, pp. 121-122.
En dépit de
l’origine matérialiste de sa pensée, on peut parler de vision prophétique de
l’Histoire chez Marx. Tout comme Condorcet, tout comme Kant et Hegel, il
annonce l’avènement d’un monde nouveau, terme nécessaire du mouvement
historique. Ce monde est pour lui une société sans classe, une société qui
mettra fin au caractère contradictoire des sociétés humaines. Société de
l’homme pour l’homme, porteuse des « lendemains qui chantent »
elle marque l’entrée de l’homme dans sa véritable Histoire.
4.3 –
Perspectives critiques
On peut tout
d’abord souligner l’originalité du point de vue Marxiste dans l’histoire de la
philosophie. Il inaugure un mode particulier de critique philosophique, que
d’autres, tels Nietzsche ou encore G. Deleuze développeront : une
philosophie du soupçon. Jusqu’à Marx, en effet, le débat philosophique
s’entendait entre gens de bonne compagnie : certes on critiquait les
concepts de ses prédécesseurs, on soulignait leurs erreurs ou leurs faiblesses,
mais on ne les accusait pas de mauvaise foi. Marx n’entre dans aucun débat
critique, ni avec les philosophes ni avec les religieux : «La critique n’a pas besoin
de chercher à s’expliquer avec cet objet, car elle sait ce qu’elle doit en
penser. Elle ne se donne plus comme une fin en soi, mais simplement comme un
moyen. Sa passion essentielle est l’indignation, sa tâche essentielle la dénonciation »
D’autre part
cette philosophie n’est pas spéculative elle se donne non comme théorie,
mais comme praxis, elle vise l’action. Depuis l’antiquité les
philosophes avaient rêvé de transformer le monde, Platon (La République,
Les lois), Aristote (le politique) ou plus près de nous Rousseau
(Contrat social) Mais aucune de ces philosophie ne débouchait sur
l’action. Marx veut faire de sa philosophie un outil de conscientisation des
masses.
Enfin, on ne peut nier l’influence qu’aura la théorie
marxiste sur les sciences humaines, la sociologie, l’ethnologie, et l’histoire,
en tant que Marx met en évidence le rôle joué par l’étiologie économique dans
les phénomènes de société. Les sciences de l’homme sont o bien des égards
redevables au marxisme d’être sorties de l’âge de l’idéologie et du subjectif.
Cependant, comme pour les autres
philosophies de l’histoire, nous nous devons d’évaluer les espoirs mis par Marx
dans le progrès historique.
Tout d’abord nous pouvons dire
que si le Marxisme se réduisait à ce que nous avons dit, il pourrait être
considéré comme une théorie naïve, un économisme simpliste. Ce danger est déjà
souligné par Engels dans le texte ci-dessous.
Selon la conception matérialiste de l’histoire, le facteur
déterminant dans l’histoire est, en dernière instance, la production
et la reproduction de la vie réelle. Ni Marx ni moi n’avons jamais affirmé
davantage. Si donc quelqu’un le dénature en ceci que le facteur économique est le
seul déterminant, il transforme ainsi cette proposition en une phrase vide,
abstraite, absurde. La situation économique est la base, mais les divers
facteurs de la superstructure -les formes politiques de la lutte des classes et
ses résultats, les constitutions établies par la classe victorieuse, etc., les
formes de droit, et même les reflets de toutes les luttes réelles dans le
cerveau des participants, théories politiques, juridiques, philosophiques,
conceptions religieuses et leur développement ultérieur en systèmes de dogmes
-exercent aussi leur action sur le cours des luttes historiques et, dans bien
des cas, en déterminent de façon prépondérante la forme, Il y a une
action réciproque de tous ces facteurs au sein desquels finalement le mouvement
économique se fraye un chemin comme une nécessité à travers la foule infinie de
hasards (c’est-à-dire de choses et d’événements dont la liaison intime entre
eux est si éloignée ou si indémontrable que nous pouvons la considérer comme
inexistante et la négliger). Sinon, l’application de la théorie à n’importe
quelle période historique serait plus simple que la résolution d’une simple
équation du premier degré.
Nous faisons notre histoire nous-mêmes, mais, en
premier lieu, suivant des prémisses et conditions très déterminées. Parmi
elles, ce sont les conditions économiques qui sont finalement décisives.
Mais également les conditions politiques, etc., voire la tradition qui hante
la tête des hommes, jouent un rôle encore que non décisif (...).
Mais, deuxièmement, l’histoire se fait de telle manière que le résultat
final se dégage toujours des conflits de nombreuses volontés singulières, dont
chacune à son tour est composée, telle qu’elle est, par une foule de conditions
particulières d’existence; il y a donc là d’innombrables forces qui se
contrecarrent mutuellement, un groupe infini de parallélogrammes de forces,
d’où ressort une résultante — l’événement historique — qui, à son tour, peut
être regardée elle-même comme le produit d’une puissance agissant comme un
tout, inconsciemment et sans le vouloir. Car ce que veut isolément chaque
individu est empêché par n’importe quel autre, et ce qui en résulte est quelque
chose que personne n’a voulu. C’est ainsi que se déroule l’histoire jusqu’à nos
jours, à la manière d’un processus de la nature, et qu’elle est soumise
essentiellement aux mêmes lois de mouvement qu’elle. Mais de ce que les
volontés individuelles — dont chacune veut ce à quoi la poussent sa
constitution corporelle et les circonstances extérieures, économiques en
dernière instance (ou ses propres circonstances personnelles ou les
circonstances sociales générales) — n’atteignent pas à ce qu’elles veulent,
mais se fondent en une moyenne, en une résultante commune. on n’a pourtant pas
le droit d’en conclure qu’elles se réduisent à zéro. Au contraire, chacune
contribue à la résultante et. dans cette mesure, y est incluse.
Engels, Lettre à Joseph
Bloch du 21 septembre 1890, Londres,
On lèvera la difficulté en
distinguant entre les causes déterminantes et les causes formelles d’un fait
historique. Les causes déterminantes sont pour Marx et Engels de nature
économique. Les causes formelles relèvent de conditions subjectives,
politiques, mythiques propres à un peuple particulier et aux hommes qui le
composent.
 La
causalité économique semble seule capable, selon nos auteurs d’unifier le
progrès historique dans une seule conception. Toutes les autres forces
présentes dans l’histoire sont incapables de se fédérer en un axe unique.
Chaque volonté particulière « tire à hue et à dia » l’histoire, et le
résultat est quelque chose que personne n’a voulu. L’image adoptée ici par
Engels est celle d’un théorème de mécanique classique, connu sous le nom de
parallélogramme de forces : F
La
causalité économique semble seule capable, selon nos auteurs d’unifier le
progrès historique dans une seule conception. Toutes les autres forces
présentes dans l’histoire sont incapables de se fédérer en un axe unique.
Chaque volonté particulière « tire à hue et à dia » l’histoire, et le
résultat est quelque chose que personne n’a voulu. L’image adoptée ici par
Engels est celle d’un théorème de mécanique classique, connu sous le nom de
parallélogramme de forces : F
Théorème :
La résultante R de
 de deux vecteurs
de deux vecteurs
concourants F et F’ est O R
égale à la diagonale
du parallélogramme
ayant ces vecteurs
comme côtés. F’
 Chaque
individu voulant dans un sens différent du vouloir des autres, la courbe
générale qui se dégage des volontés particulières semble indéterminable. Marx
et Engels pensent avoir trouvé dans la causalité économique le seul vecteur
capable d’unifier l’ensemble de ces tendances divergentes. Courbe
Chaque
individu voulant dans un sens différent du vouloir des autres, la courbe
générale qui se dégage des volontés particulières semble indéterminable. Marx
et Engels pensent avoir trouvé dans la causalité économique le seul vecteur
capable d’unifier l’ensemble de ces tendances divergentes. Courbe
de l’histoire
Volontés
particulières
divergentes
Causalité
économique
Mais ceci suffit-il à établir de
manière satisfaisante la lecture déterministe et positive que Marx et Engels
font de l’histoire ?
Un constat s’impose : loin
de mettre fin au régime contradictoire existant dans les sociétés que Marx
désignait du nom de « préhistoire de l’humanité », le passage à la
société communiste, dans les divers exemples historiques qui nous sont connus
n’ont pas supprimé les antagonismes de classe, il les a simplement déplacés et
transformé. Ainsi les divers régimes socialistes marxistes et léninistes en ex.
URSS, en Chine, en ex. Yougoslavie, à Cuba, en Chine en Albanie, en Roumanie se
sont tous transformés de dictature du prolétariat
qu’ils étaient, en tyrannie personnelle ou encore en bureaucratie accordant des
privilèges aux membres d’une intelligentsia ou d’une nomenklatura,
en bref d’une oligarchie.
D’autre part l’analyse de Marx,
appliquée aux nations occidentales demanderait pour le moins un complément
théorique : existe-t-il encore en France une classe ouvrière se pensant
comme telle à travers sa « conscience de classe » ? Peut-être
qu’elle s’est laissée doucement embourgeoiser et que l’automobile et le
pavillon de banlieue, symbole de l’individualisme petit-bourgeois ont eu raison
de la conscience de classe.
Enfin, le capitalisme et son
corrélat théorique, le libéralisme, ne sont pas mort, loin de là. D’une part
parce que le colonialisme, puis le néo-colonialisme ont permis à ce régime
d’échapper à une crise radicale et aussi parce que les inégalités se sont déplacées.
Et d’autre part, même s’il y a toujours des inégalités criantes internes aux
nations occidentales, elles le sont encore plus concernant les peuples de ce
que l’on appelle, en langue politiquement correcte, le tiers monde. Le retour à
la croissance des nations occidentale ne semble pas promettre la diminution de
ces inégalités, bien au contraire.
Conclusion : Rousseau et
Lévi-Strauss, la fin des illusions.
Il semble que toutes les
philosophies de l’histoire, de Condorcet à Marx se soient bercées d’illusions
sur la nécessité du progrès historique, sur la certitude qu’au bout de
l’histoire l’homme trouverait une cité juste, une utopie. Il semble que la
faute en soit, de manière générale, à une confiance aveugle accordée aux
progrès de la raison, foi héritée des Lumières, au détriment d’une
interrogation sur le vouloir, sur la volonté des hommes à construire un monde
meilleur. On observera qu’il s’agissait là d’une illusion mortelle : le
sociologue E. Morin a bien montré que la rationalité avait
dégénéré en rationalisations, c’est à dire en raison
instrumentale ayant perdu ses fondements moraux comme sa finalité.
Et si Rousseau avait eu
raison ? Et si l’illusion première avait été de croire que l’insociable
sociabilité pouvait être éradiquée de la société ?
A quel prix pourrait-on
d’ailleurs le faire ? Supprimer cette contradiction n’est possible que
dans un état totalitaire, négation de l’individu et au-delà de la personne, un
état où toute revendication particulière soit bannie. C’est ce qu’on compris
les divers auteurs de contre-utopies, tel Aldous Huxley.
« Aucune société n’est
parfaite, mais aucune n’est non plus foncièrement mauvaise ; toutes
comportent une part irréductible d’iniquités en contradiction avec les
principes qu’elles proclament » nous dit Claude Lévi-Strauss dans Tristes
Tropiques. En fait, vouloir réaliser sur terre un meilleur des mondes,
c’est oublier que Dieu lui-même l’a située hors de nos prises : la cité
des justes est une Jérusalem céleste, non une Jérusalem terrestre. L’oublier, c’est s’apprêter à entrer dans
l’inhumain : vouloir rivaliser avec les dieux est aussi mortel pour
l’homme que de retourner à la brute. Dans Le meilleur des monde tout est
fait pour éviter le moindre trouble social ; les enfants sont conçus et
développés in vitro, puis conditionnés à leur futur rôle social, de telle sorte que ne
subsiste en eux aucune envie d’être différents de ce que la programmation a
prévu ; Alpha, bêta, gamma, resteront alpha, bêta et gamma, sans désir de
quitter leur condition, jusqu’à leur mort. Les femmes qui ne mettent plus
d’enfant au monde, prennent des substituts de grossesse, pour éviter d’être
malheureuse : car le malheur doit être proscrit, le bonheur est devenu un
devoir.
Une telle société est
manifestement un enfer. Le droit d’être malheureux, le droit d’être déviant, le
droit à la différence, voici ce que réclamera finalement le héros.
Mais la fiction n’est peut-être
pas éloignée de tentatives de normalisations, d’eudémonisme
contraint, ou d’hédonisme
de super marché. Et ceci n’est pas seulement le cas des pays totalitaires, mais
le danger guette aussi les sociétés qui ont fait trop confiance à la techno
science pour bâtir la « cité du bonheur. »
Faut-il pour autant désespérer de
l’Histoire ? La leçon de Rousseau tient dans une phrase :
L’âge d’or, qu’une
absurde superstition avait placé en deçà [ou au delà]de
nous,
L’âge d’or est en nous.
Cela signifie que nous n’avons
pas plus à regretter le jardin de nos premiers parents
qu’à attendre de l’histoire d’improbables lendemains qui chantent. Cela
signifie « retroussons nos manches » et que l’effort pour
bâtir un monde meilleur (et non pas un monde parfait), l’effort pour lutter
contre l’injustice, la souffrance, la bêtise, cet effort peut-être entrepris tous
les jours, solidairement, et sera demain encore à recommencer.
La cité présente mérite qu’on s’y intéresse ; non pas en rêvant
d’une illusoire utopie, mais en luttant au quotidien.
M. Le Guen (04/2001)










